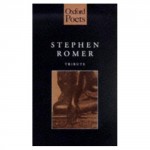samedi, 18 novembre 2006
Philippe Jaworski à Tours
Comme elle traîne, avec l'aide d'une camarade, un énorme sac de voyage, d'une salle à l'autre, toute la journée, elle m'explique qu'elle habite à Varennes, et n'a même pas besoin de préciser que le Lochois est terriblement enclavé, car c'est bien connu dans le département. Trains et cars, et les cours du vendredi soir qui décalent son départ au lendemain, parfois tard. (Pourquoi le sac, alors ?)
Elle habite Varennes, qui semble être, dans ce dialogue, le bout du monde, coin perdu. Suis-je jamais allé à Varennes ? Un de mes collègues, que j'aime bien, y habite, avec sa femme et ses filles. (J'écris ces lignes sur le canapé de la chambre beige, où la longue portée du WiFi tourne court. Je devrais plutôt travailler sous Word. (« Sous Word » : ça se voit que je suis en train de lire Prunus spinosa.))
Il est donc question de Varennes, où sans doute je ne suis jamais passé (mais tout de même, samedi dernier, n'y étions-nous pas, entre Loches et ce château robuste et sévère plus au sud ?). Les lignes de fuite de la soirée me conduisent à la librairie, où, deux heures durant, j’écoute Philippe Jaworski, remarquable traducteur, austère et exigeant, de Moby Dick notamment, et responsable de la publication de l’édition des œuvres en prose de Melville dans la Pléiade (le troisième tome vient de sortir). C’est un homme qui prend le temps de parler en détail, de manière approfondie, à mille lieues de la culture contemporaine du zapping et du saupoudrage, ce qui a l’air de décontenancer même certains habitués de la librairie Le Livre. Ses paroles, parfois l’air de rien, ont une longue résonance. Certains dormaient hier soir, ne s’en cachant même pas.
Juste avant d’évoquer Varennes, j’avais vivement encouragé les deux porteuses de sac (et leurs camarades) à aller écouter Philippe Jaworski. De la fuite aux fanons, il n’y a qu’un pas, canon-harpon ou pas.
Ce matin, j’ai appris que le fils cadet d’un ancien collègue de mes parents – un garçon de deux ans plus jeune que moi, avec qui parfois je jouais au tennis, enfant – s’est tué en faisant une chute vertigineuse du haut d’une statue, à Barcelone. Son père est professeur d’arts plastiques, et sculpteur.
Philippe Jaworski a dû repartir à Paris, et mon étudiante à Varennes. Je suis face à l’écran, sur les nerfs.
11:11 Publié dans Âcres fins | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Ligérienne
mardi, 07 novembre 2006
Stephen Romer siffle un air mort
Il s'évente avec quelques phrases, que, l'air de rien, l'air lui dérobe pour les emporter par-dessus les montagnes. Il s'offre une valse avec l'azur, mais c'est pour mieux nier qu'il y a des nuages. À la nue insolente soubrette il réplique par un non sequitur. Toutes proportions gardées.
13:00 Publié dans Âcres fins | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie, Littérature
mercredi, 13 septembre 2006
Vitaliano Trevisan dans son vison italien
Vitaliano Trevisan dans son vison italien ne peut pas vraiment être italien, me dis-je, ni habiter Trévise, pensai-je en refermant le long livre à la couverture jaune, non sans avoir mûrement réfléchi à ce que je lui écrirais, à lui, à Vitaliano Trevisan, à cet homme photographié en quatrième de couverture dans son vison italien, pensais-je en envisageant de lui écrire. Il faut que je vous reproche, lui écrirai-je, d’être trop ouvertement influencé par les récits brefs de Thomas Bernhard, et j’en sais quelque chose, moi qui me suis plusieurs fois retenu de prendre la plume pour écrire un récit bref à la manière de Thomas Bernhard après avoir lu un récit bref de Thomas Bernhard, lui écrirai-je, pensai-je en refermant le livre. Il faut que je vous reproche, lui écrirai-je, de m’avoir infiniment séduit, et comme j’ai lu votre « compte rendu » dans la traduction de M. Jean-Luc Defromont, comme je ne suis pas apte à lire l’italien dans le texte, de m’avoir poussé à m’interroger sans cesse quant au responsable de cette parenté si évidente entre votre prose et celle de Thomas Bernhard, que j’ai lue tantôt en allemand tantôt en traduction française, pensais-je que je lui écrirais. Le responsable est-il l’auteur ou le traducteur, pensais-je. Le responsable est-il le traducteur ou l’auteur, lui écrirai-je. Sans doute, pensais-je, me répondra-t-il que les deux sont responsables, que l’auteur est coupable d’avoir subi l’influence de Thomas Bernhard et que le traducteur est coupable de s’être trop référé aux traductions françaises des récits de Thomas Bernhard, m’écrira-t-il, pensais-je. Et il faut que je vous reproche, m’imaginai-je lui écrire, d’avoir écrit une histoire si obsédante et si bouleversante qu’on ne peut pas s’empêcher de vouloir en faire un film et que, dans le même temps, tout film trahirait inévitablement le point de vue du narrateur et l’esthétique même de votre récit, de sorte que c’est une histoire de fous, lui écrirai-je, qu’on se sent obligé d’adapter votre récit à l’écran, comme on dit sottement, lui écrirai-je, mais que cela est, dans le même temps, rigoureusement impossible, comme on dit sottement, lui écrirai-je, comme il était impensable d’adapter les récits de Thomas Bernhard à l’écran, l’ombre moqueuse et bientôt injurieuse de l’écrivain planant sur tout projet de ce genre, car il n’eût pas manqué de vomir toute tentative d’adapter ses récits brefs ou moins brefs à l’écran, pensais-je, et d’ailleurs il en est du film comme de la langue, on ne sait si c’est une question de langue – l’allemand, l’italien ou le français – ou de projet esthétique, et finalement, lui écrirai-je, la seule chose de sûre c’est que j’ai lu votre texte en français, pensais-je, et que j’écris moi-même cette lettre en français, de sorte qu’on est sûr que je suis, pour ma part, influencé tant par les traducteurs de Thomas Bernhard que par le vôtre, et que vous ne pourrez peut-être même pas me répondre en français, lui écrirai-je, pensais-je. En tout cas, pensai-je en refermant le long livre à la couverture jaune, je ne lui écrirai pas que Loupinot court plus vite que le zébu du coin, parce que, pensai-je, cela n’a aucun rapport avec son « compte rendu » ni avec mon envie d’en tirer un film, comme on dit sottement, pensais-je, ni non plus avec l’influence des récits brefs de Thomas Bernhard sur son écriture ou sur le travail de son traducteur, et il faudrait, pensai-je, que je songe à lui demander si c’est bien du vison italien que lui, Vitaliano Trevisan, porte sur la photographie en quatrième de couverture, à moins que je ne m’abstienne de le lui demander, pensai-je, et que je préfère écrire un compte rendu de son « compte rendu », c’est-à-dire que j’écrive, pensais-je, un vrai compte rendu (ou une recension, ou un article de critique) du récit de Vitaliano Trevisan, dont le sous-titre est, une fois encore sous l’influence de Thomas Bernhard, pensais-je, « Un compte rendu », alors que c’est un récit et que le compte rendu est l’œuvre du narrateur fictif, ce qui fait que seul mon compte rendu sera vraiment un compte rendu, car je ne voulais pas à ce moment, pensai-je, entrer dans les subtilités sémantiques du mot compte, qui était aussi relatif au décompte des pas, et même des quinze mille pas éponymes, comme, pour ma part, je peux, selon une coutume qui m’est chère, vous affirmer, sans entrer dans le détail des allers ni des retours, que ce texte compte exactement quatre mille cinq cents signes en comptant les espaces, pensai-je.
10:54 Publié dans Âcres fins | Lien permanent | Commentaires (6)
lundi, 11 septembre 2006
Éric Chevillard, riche vieillard ?
Il met la dernière main, mine de rien, à son soixante-dixième roman. Il a quatre vingt dix-neuf ans, est entouré d’honneurs et couvert de jeunes filles (à moins que ce ne soit l’inverse) et de femmes moins jeunes mais plus expertes encore dans le déduit. Tu es parvenu à tes fins, hein ?
Mine de rien, il va publier son soixante-dixième roman, plus beau et plus drôle que tous les précédents, Maintenant roule. Il avait songé à Maintenant rouge, ou Maintenant rousse, mais c’est plus amusant comme cela. Les titres l’obsèdent de plus en plus, mais il refuse de l’avouer, de crainte que l’on ne pense qu’il joue les divas. Il est resté plus simple d’abord que jamais, et mystérieux aussi, à sa façon.
Depuis Vieille barbe, publié en 2039, il n’a plus un poil sur le caillou.
Depuis La Lune pour ne rien dire, publié en 2045, il n’a plus vraiment décroché de sa console de jeux intersidérale.
Depuis Gamin, au panier !, publié en 2021, et dans lequel il se risquait, par le biais d’une métaphore sportive, à critiquer la politique d’émigration choisie du gouvernement de centre-droit dirigé par Marine Le Pen, on ne lui parle plus trop de politique, et lui non plus n’en est pas très friand. D’ailleurs, qui s’y risque encore ?
Depuis Les Stratagèmes de la pierre précieuse, publié en 2033, il n’a cessé de parler d’or, ce qui le changeait de ses braquages de jeune homme.
Depuis Zoziau aveugle, publié en 2057, sa vue s’est encore améliorée, et il peut écrire de plus belle sur l’œuvre des peintres aimés.
On ne sait plus très bien combien il touche chaque année en droits de traduction, d’adaptation à l’écran. Ça n’intéresse pas grand monde, car le bougre sait se faire oublier. Mais les premiers mots de Maintenant roule, des dizaines de milliers de groupies sont prêts à les boire à même ses lèvres, et au fond de son œil malicieux on devine encore l’amusement que procurent, dans son esprit, ce grand malentendu qui se prolonge.
18:25 Publié dans Âcres fins | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 31 août 2006
Franz Kafka rend son tablier
Convoqué au tribunal des animaux, il fut surpris de voir un éléphant prendre sa défense. C'est le comble, pensa Frank, en courant se cacher dans son grenier.
15:42 Publié dans Âcres fins | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 26 août 2006
César Aira ira à la césure
Dormez sur les toits, criez la joie des sphères à la face des gouffres. La mélasse guette d'autres larmes, d'autres printemps, et des gymnases effondrés sous le poids des bombes.
Dancing, vu hier, est un film curieux, qui fait se rencontrer des recherches plastiques nettement contemporaines, des cadrages plutôt baroques (dans une veine proche de Greenaway et de Vermeer) et un tissu narratif hérité du Horla. Bien sûr, on ne compte plus les "réécritures" (ni les interprétations) du Horla.
Je voudrais, écrit César Aira, m'installer six mois à Lahore et réécrire plusieurs nouvelles de Maupassant. Je ne veux pas entendre parler des ces petites-filles d'Emma Bovary, ni des ces Monsieur Bovary dont on nous rebat les oreilles, écrit César Aira. Les chaloupements dorés des cordes de Marc Buronfosse font languir même les nuages, écrit César Aira, à Lahore.
Sur la pochette du premier disque enregistré par Bojan Zulfikarpasic en leader, Marc Buronfosse est le seul à ne pas sourire, mais à affronter le regard du photographe, mi-serein mi-inquiet. Les sourires et rictus de René "Bear" n'ont rien de commun avec l'univers débridé mais sans folie qui se dessine dans Mashala ou dans Ginger Pickles, écrit César Aira, devenu, à son insu, critique de jazz et vidéaste amateur.
09:49 Publié dans Âcres fins | Lien permanent | Commentaires (6)