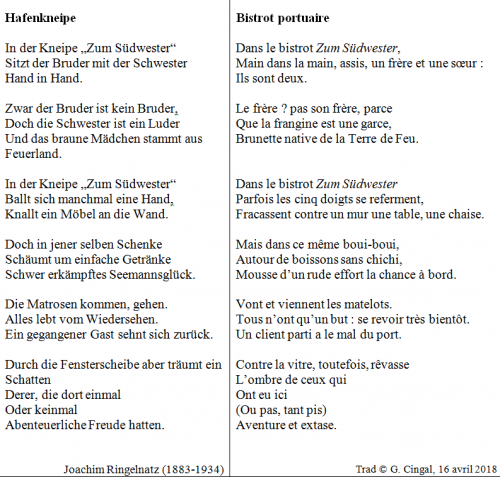mardi, 14 mai 2019
Der Baum / L'arbre
Aus seinen Wurzeln
Depuis ses racines
wächst er
il croît
dem Himmel zu
jusqu'à toucher le ciel
Ringe
Des anneaux
umschlingen sein Herz
lui enlacent le cœur
erzählen seine Jahre
racontent ses années
Vögel verstehen
Les oiseaux comprennent
seine Laubsprache
le langage de son feuillage
Wer ihn fällt
Celui qui l'abat
erkennt sein Alter
découvre son âge
nicht
mais pas
seine Jugend
sa jeunesse
06:31 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 13 mai 2019
Der Brunnen III / Le puits III
Ich komme zurück
Je m'en reviens
zum Brunnen
au puits
noch hängt an der Kette
à la chaîne pend encore
der Eimer
le seau
Ich tauche ihn
Je le plonge
in die Tiefe
dans les profondeurs
hole ihn hoch
puis le remonte
trinke Erinnerung
je bois un souvenir
über den Himmel
penchée
gebeugt
au-dessus du ciel
13:55 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 12 mai 2019
Der goldne Berg / La montagne dorée
Der goldne Berg
La montagne dorée
im Gedächtnis
dans ta mémoire
strahlt
étincelle
Sein Gipfelgruß
Son salut depuis le sommet
umarmt das Tal
étreint la vallée
Öffne deine Fenster
Ouvre la fenêtre
laß die Sonne herein
laisse entrer le soleil
Wirf deine Masken
Jette tes masques
ins Feuer
dans le feu
empfange das Licht
accueille la lumière
07:02 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 11 mai 2019
Der Himmel II / Le ciel II
Meine Mutter
Ma mère m'a
schenkte mir die Erde
offert la terre
und hat mir
et m'a
den Himmel vermacht
légué le ciel
der mir die Mutter
que la mère m'a
gab
donné
und nahm
puis repris
07:58 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 10 mai 2019
Der Seher / Le guetteur
Der Seher
Le guetteur
sieht
aperçoit
die schwarze Fahne
le drapeau noir
auf halbmast
en berne
Das Haus ist gestorben
La maison est morte
die Straße begraben
la rue ensevelie
die Stadt war
la ville était
eine wahre Erfindung
une vraie trouvaille
Der Seher
Le guetteur
sieht
aperçoit
Moos
de la mousse
07:49 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 09 mai 2019
Heimat II / Patrie II
Du schwimmst
Tu nages
auf dem Meer
sur la mer
der Unendlichkeit
de l'infini
Glückt es dir
Si tu as la chance
eine Küste zu erreichen
d'atteindre une côte
wird ein Stückchen Erde
un lopin de terre
deine Heimat
devient ta patrie
09:59 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 08 mai 2019
Briefe II / Lettre II
Jeden Tag
Chaque jour
kommt der Briefträger
le facteur passe
und bringt mir ein Stückchen Welt
et m'apporte un morceau d'univers
Viele Unbekannte
Tant d'inconnus
erzählen mir
me racontent
ihre Geschichten
leurs histoires
schenken mir
m'offrent
Freundschaft und Liebe
leur amitié et leur amour
Ihre Worte umarmen
Leurs paroles étreignent
meine Worte
mes paroles
07:37 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 07 mai 2019
Baum / Arbre
Ich bin ein Baum
Je suis un arbre
voller Vögel
couvert d'oiseaux
trinke ihren Gesang
je bois leur chant
Aus den Wurzeln
Depuis les racines
wächst mein Schicksal
monte ma destinée
Schmerz und Sprache
la souffrance et la parole
ins Staunen
devenues enchantement
07:39 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 06 mai 2019
Ballspieler / Joueur de ballon
Gefühl des Abstands
Sens de la distance
Angriff und Schwung
attaque et course d'appel
Jedes Vielleicht
Au moment du tir il
wägt er im Wurf
soupèse chaque hypothèse
Wenn der Ball kommt
Quand le ballon
aus der Sonne —
descend du soleil —
das Licht ist ein Spiel
la lumière est un jeu
roter Bälle
de ballons rouges
Unter allen Sonnenbällen
De tous ces ballons du soleil
den festen
la main
fängt die magnetische
magnétique attrape le
Hand auf
seul ballon solide
06:05 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 05 mai 2019
Entfernt / Eloignée
Ich bin weit entfernt
Je suis très éloignée
von mir
de moi-même
Komme mir
Viens au-devant
selber entgegen
de moi-même
und erwarte mich
et attends-moi
Die Erwartung bleibt
L'attente demeure
hinter mir zurück
en arrière de moi
15:19 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 04 mai 2019
Dulcinea / Dulcinée
Wo
Où
schläft mein Ritter
dort mon chevalier
Ich Dulcinea
Moi, Dulcinée,
Kuhmagd
qui suis vachère,
dien ihm im Stall
je le sers à l'étable
Spanische Königstochter
princesse espagnole
vor der Gerburt
de par ma naissance
Das weiß
Cela, il le sait,
Don Quichotte
Don Quichotte
beweist es den Mühlen
il le démontre aux moulins
die mich verspotten
qui se gaussent de moi
Viele Tode gestorben
De tant de morts pour moi
für mich
il est mort
Melk ich die Zeit
Je trais le temps
schwimmt
son visage
sein Gesicht
flotte
im weißen Spiegel
dans le miroir blanc,
verjüngt
rajeuni
Ich melke
Je trais
für Spanien
pour l'Espagne
für dich
pour toi
Die Toten werden nicht alt
Les morts ne vieillissent pas
06:34 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 03 mai 2019
Der Tag / Le jour
Der Tag ist ein Berg
Le jour est une montagne
Du mußt ihn täglich besteigen
Chaque jour tu dois l'escalader
Lawinengeröll
éboulis d'avalanches
Taugras Wipfel die
herbe-rosée & cimes qui
den Himmel im
tiennent le ciel
Gleichgewicht halten
en équilibre
08:03 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 mai 2019
Don Quichotte II
Ich Dulcinea
Moi, Dulcinée
warte auf meinen Ritter
j'attends mon chevalier
der zarten Gedanken
aux douces pensées
Einst kam er
Autrefois il est venu
auf einem Flügelroß
sur un cheval ailé
und ritt mit mir
et nous avons cavalé
zu den Sternen
jusqu'aux étoiles
Wir fielen
Nous sommes tombés
er starb
il est mort
Ich liege in einer Wüste
Me voici étendue dans un désert
ohne Oase
sans la moindre oasis
warte auf meinen
j'attends mon
auferstandenen Ritter
chevalier ressuscité
06:31 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 01 mai 2019
Regenwörter / Mots de pluie
Regenwörter
Des mots de pluie
überfluten mich
m'inondent
Von Tropfen aufgesogen
Gorgée de gouttes
in die Wolken geschwemmt
flottée sur les nuages
ich regne
je pleus
in den offenen
et j'atterris dans la
Scharlachmund
bouche ouverte écarlate
des Mohns
du coquelicot
________________________________________
Ce poème, comme les autres que je traduirai en mai, est extrait du recueil Die Sonne fällt (1984, Fischer Verlag, 2001, p. 123).
Il n'y a aucun marqueur de genre dans le poème, et l'instance qui dit "je" n'est pas forcément identique à la poète. Toutefois, je choisis le féminin, car traduire au masculin "par défaut" me semble fort peu satisfaisant également. Je n'ai jamais lu de traductions françaises d'Ausländer, donc j'ignore comment procèdent les autres.
"je pleus" : faut-il conjuguer le verbe pleuvoir comme émouvoir (j'émeus) ou comme pouvoir (je peux) ?
EDIT du 2 mai : suite aux explications et conseils de Lionel-Edouard Martin, j'ai changé mes vers 3 et 4 ; je n'ai pas osé suivre toutes les émendations de mon éminent collègue, mais qu'il soit ici remercié.
06:49 Publié dans Rose Ausländer | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 20 avril 2018
DSF15 (#Braddon1868)
Chapitre III. [version intégrale]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.
Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.
Votre ami sincère à tout jamais,
H.
Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.
— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),
ma chère à tout jamais,
il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.
Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.
H, à toi pour toujours,
Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.
Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.
Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque. Ces mèches noires désordonnées étaient parsemées de fils d'argent, et sa moustache noire avait de ces reflets pourpre qui trahissent la main de l'apothicaire. C'était un homme grand et robuste, d'allure imposante ; et quoique les grâces habituelles de l'homme moderne lui fissent défaut, il avait quelque chose de racé, un style bien à lui. En ce jour, il portait le deuil, et ses manières avaient une douceur inaccoutumée. C'était Daniel Mayfield, un homme dont le génie avait bien servi les autres, mais été de peu de secours pour lui-même, un homme qui contemplait le visage de son pire ennemi à chaque fois qu'il regardait dans un miroir.
Oui, M. Mayfield ne s'était pas fait d'autre ennemi que lui-même. Il était aimé de tous. C'était lui, le vrai bohémien, l'Arabe typique arpentant le grand désert londonien. L'argent, comme de l'eau, lui filait entre les doigts. Il avait eu plus de réussite, et travaillé davantage que des hommes dont le labeur s'était traduit en terres et demeures, chevaux et calèches, fins linges brodés et porcelaines de Sèvres. Les gens qui le connaissaient passaient leur temps à calculer ses revenus et à se demander ce qu'il en faisait. Dépensait-il tout au jeu ou dans des spéculations boursières ? Ces quinze cents livres de revenu annuel, les buvait-il dans les tavernes ? Daniel lui-même eût été dans l'impossibilité de répondre. Cette énigme mystérieuse l'intriguait autant que les autres. Il n'avait jamais compris où passait son argent. L'argent filait, d'une manière ou d'une autre ; voilà tout.  Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.
Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.
Désormais son génie téméraire avait un peu pâli. La férocité des yeux noirs était atténuée par un air de continuelle tristesse, et la démarche arrogante du bohémien avait laissé la place à une figure et à un maintien inhabituellement calmes. Il demeura quelque temps sur le seuil à regarder son neveu. Le jeune homme leva les yeux brusquement et étira les mains.
— Cher oncle Dan ! s'écria-t-il en saisissant les mains que lui tendait son visiteur.
Il ne reçut, pour toute marque de compassion de la part de son oncle, qu'une pression énergique de ses doigts robustes. Les deux hommes se comprenaient trop bien pour avoir besoin de se répandre en paroles.
Daniel fixa le bureau avec sa planchette relevée.
— Alors, dit-il doucement, tu as examiné les papiers de ta mère... As-tu découvert quelque chose ?
— Plus qu'il n'est nécessaire, et pas la moitié, malgré tout, de ce que je dois savoir. Cela viendra. Oncle Dan, je ne t'ai jamais posé de questions. Je n'en trouvais pas la force. Mais maintenant... maintenant qu'elle n'est plus...
— Je te comprends, mon garçon. J'en sais moi-même assez peu, car je n'ai jamais trouvé la force de l'interroger (que Dieu la bénisse !), mais tu as le droit de savoir ce peu de choses, et si tu es en mesure de nouer les fils de l'histoire avec ce que tu as trouvé là-dedans...
En disant ces mots, Daniel lui montrait le bureau.
— Je comprends ce qui s'est passé ; ce que je veux savoir, c'est le nom de cet homme ! s'emporta Eustace.
— Cela fait vingt ans que je désire le savoir.
— Alors tu ne peux rien me dire ?
— Je peux t'en dire fort peu. Quand je suis parti de chez moi pour effectuer un stage dans un cabinet d'avocats londoniens, j'ai laissé derrière moi la plus belle et la plus lumineuse de toutes les créatures dont jamais frère ait pu se dire fier. Tu le sais, Eustace, nous étions les deux seuls enfants d'un couple de commerçants prospères dans une petite ville d'eaux. Nous habitions une maison de briques carrée qui donnait sur la mer. Mon père tenait une bibliothèque ambulante avec salon de lecture, et ma mère faisait dans la chapellerie. À eux deux ils avaient un revenu tout à fait confortable. Bayham était une petite ville endormie, loin du tumulte du monde ; un commerçant qui réussit à s'y établir finit par y bénéficier d'un bon petit monopole. Je sais que nous avions du bien et qu'à notre façon nous étions des gens importants. Ma sœur était, de Bayham, la plus belle fille. Elle a fané si vite, elle est devenue une telle épave qu'il t'est difficile d'imaginer quelle beauté c'était alors. Elle avait honte que sa beauté lui valût autant d'attention, et ses timidités d'enfant la rendaient plus charmante encore. Un grand échalas empoté de dix-huit ans ne sait guère ce qu'est la beauté, mais je savais que ma sœur était adorable ; je l'aimais et je l'admirais. Je me rappelle que je n'arrêtais pas de vanter ses mérites auprès des autres clercs, et qu'à force de dénigrer leurs sœurs du haut de mon ignorance j'avais fini par me rendre insupportable. J'étais si fier de notre petite Cely.
Il s'arrêta de parler, se couvrit les yeux de ses mains pendant quelques minutes, cependant qu'Eustace attendait impatiemment.
— Pour aller à l'essentiel, poursuivit-il, mon père a fini par m'écrire une lettre, au ton très perturbé, aux formulations presque incohérentes, afin de me dire que la maison était sens dessus dessous, et que je devais rentrer sur-le-champ. Bien sûr, je pensai d'abord à des problèmes d'ordre pécuniaire (je gage que la nature a fait de nous des êtres mesquins) et, me figurant que le commerce était ruiné, j'ai songé, rongé par le remords, à tout l'argent que j'avais coûté à mon père, et à la façon dont, depuis toujours, j'avais été un bien piètre fils. En rentrant à Bayham, j'ai découvert qu'une chose plus grave que le manque d'argent avait frappé d'affliction notre famille. Celia avait disparu en laissant une lettre dans laquelle elle disait à mon père qu'elle partait se marier ; il y avait des raisons de tenir secrets quelque temps le mariage et le nom même de son époux ; mais il avait promis de la ramener à Bayham dès qu'il serait libre de révéler son nom et son rang. Bien entendu, nous savions ce qu'il fallait comprendre par là ; mon père et moi partîmes en quête de notre pauvre fille dupée, le cœur frappé d'un désespoir aussi noir que si nous étions partis la chercher au royaume de Pluton.
— Et vous avez échoué...?
— Oui, mon garçon, nous avons ignoblement échoué. En ce temps-là, il n'y avait ni télégraphe ni détectives privés ; et après avoir suivi plusieurs fausses pistes, et dépensé pas mal d'argent, nous sommes rentrés à Bayham, mon père avec dix ans de plus pour tribut de ses peines. Il mourut trois ans plus tard, et ma mère ne tarda pas à le suivre, car c'était un de ces couples de l'ancien temps, qui s'accrochent l'un à l'autre si passionnément leur vie durant qu'il leur faut bien descendre ensemble à la tombe. Ils moururent, et la pauvre fille, à qui ils avaient pardonné dès la minute où ils avaient appris son offense, ne put soulager leurs derniers instants. Ils étaient morts depuis plus d'un an lorsque je vis un visage de femme me frôler dans la partie la plus animée du Strand. Je poursuivis mon chemin en ressentant au fond de mon cœur une étrange et subite douleur, avant de rebrousser chemin et de me lancer à la poursuite de cette femme, car je savais que j'avais vu ma sœur.
Il y eut une nouvelle pause, durant laquelle on n'entendit que la respiration haletante d'Eustace, et un long soupir, poussé par Daniel.
— Eh bien, mon garçon, elle vivait à Londres depuis plus de trois ans, cachée dans cette même immense jungle qui m'abritait, et pas une fois la Providence ne m'avait placé sur son chemin. Elle avait mené la vie qui est celle de tant d'autres créatures solitaires à Londres, en vivotant, tantôt grâce à telle besogne, tantôt grâce à telle autre. Je la raccompagnai chez elle ; nous rassemblâmes ses quelques menus biens, nous les emportâmes dans un fiacre, avec toi... et tu connais la suite. Elle a vécu avec moi jusqu'à ce que tu atteignes l'âge où les mauvaises influences sont à craindre : alors, elle prit quelque excuse pour s'en aller ; la pauvre âme, elle avait peur que ce débauché de Daniel ne contaminât son petit agneau. Pendant tout le temps où nous vécûmes ensemble, je me retins de l'interroger. J'étais persuadé qu'elle finirait par se confier à moi, et, espérant cela, j'attendais patiemment. Une fois, elle m'apprit qu'elle s'était rendue par deux fois à Bayham : la première, quand ses parents étaient encore en vie ; elle avait attendu et guetté, dissimulée par l'obscurité hivernale, jusqu'à parvenir à les apercevoir tous deux ; la seconde, quand ils reposaient déjà dans le cimetière paroissial. Elle ne m'a jamais rien dit d'autre. Un jour, je lui ai demandé si elle me dirait le nom de ton père. Mais elle m'a regardé d'un visage aussi triste qu'effrayé, la pauvre enfant, et m'a dit que non, elle ne pourrait jamais me dire cela ; il n'était pas en Angleterre... il était, à ce qu'elle croyait savoir, à l'autre bout de la terre. C'est la seule tentative que j'aie jamais faite pour deviner le secret de ta naissance.
— Mais les lettres, les lettres de cet homme, regorgent d'allusions à un mariage. Crois-tu qu'il n'y a pas eu de mariage ?
— Pas de mariage. Je suis catégorique.
Eustace eut un râle. Longtemps, il s'était douté de cela ; mais son amertume grandissait à entendre ses doutes confirmés par quelqu'un d'autre, de sorte qu'il demanda :
— Tu as une bonne raison de dire cela, Oncle Dan ?
— Eustace, j'ai la conviction absolue que si ma sœur avait pu revenir à Bayham, elle l'aurait fait. Sa peine a dû être bien amère pour qu'elle reste éloignée de ses parents.
 Le jeune homme ne répondit rien à son oncle. Il alla à la fenêtre et se mit à observer le spectacle lugubre de la rue, où l'inévitable joueur d'orgue, qui, avec sa manivelle à musique, a toujours l'air de mouliner nos peines, égrénait ses ritournelles à sa place habituelle. Pour le commun des mortels, sa mélodie était un air d'Éthiopie, mais, par la suite, Eustace ne devait jamais, en entendant cet air, oublier ces instants malheureux, ni l'histoire infortunée de sa mère.
Le jeune homme ne répondit rien à son oncle. Il alla à la fenêtre et se mit à observer le spectacle lugubre de la rue, où l'inévitable joueur d'orgue, qui, avec sa manivelle à musique, a toujours l'air de mouliner nos peines, égrénait ses ritournelles à sa place habituelle. Pour le commun des mortels, sa mélodie était un air d'Éthiopie, mais, par la suite, Eustace ne devait jamais, en entendant cet air, oublier ces instants malheureux, ni l'histoire infortunée de sa mère.
Il s'en retourna près de son oncle. Que le Ciel le prenne en pitié, il n'était pas jusqu'à la loi qui ne lui déniât ce lien, et s'il pouvait dire de cet homme que c'était son oncle, c'était pure courtoisie. S'éloignant de la fenêtre, il se jeta contre la poitrine de son oncle, l'honnête Daniel, et fondit en larmes.
— Emmène-moi sur la tombe de ma mère.
10:39 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 17 avril 2018
DSF14 (#Braddon1868)
Chapitre III. [en cours de traduction]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.
Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.
Votre ami sincère à tout jamais,
H.
Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.
— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),
ma chère à tout jamais,
il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.
Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.
H, à toi pour toujours,
Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.
Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.
Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque. Ces mèches noires désordonnées étaient parsemées de fils d'argent, et sa moustache noire avait de ces reflets pourpre qui trahissent la main de l'apothicaire. C'était un homme grand et robuste, d'allure imposante ; et quoique les grâces habituelles de l'homme moderne lui fissent défaut, il avait quelque chose de racé, un style bien à lui. En ce jour, il portait le deuil, et ses manières avaient une douceur inaccoutumée. C'était Daniel Mayfield, un homme dont le génie avait bien servi les autres, mais été de peu de secours pour lui-même, un homme qui contemplait le visage de son pire ennemi à chaque fois qu'il regardait dans un miroir.
Oui, M. Mayfield ne s'était pas fait d'autre ennemi que lui-même. Il était aimé de tous. C'était lui, le vrai bohémien, l'Arabe typique arpentant le grand désert londonien. L'argent, comme de l'eau, lui filait entre les doigts. Il avait eu plus de réussite, et travaillé davantage que des hommes dont le labeur s'était traduit en terres et demeures, chevaux et calèches, fins linges brodés et porcelaines de Sèvres. Les gens qui le connaissaient passaient leur temps à calculer ses revenus et à se demander ce qu'il en faisait. Dépensait-il tout au jeu ou dans des spéculations boursières ? Ces quinze cents livres de revenu annuel, les buvait-il dans les tavernes ? Daniel lui-même eût été dans l'impossibilité de répondre. Cette énigme mystérieuse l'intriguait autant que les autres. Il n'avait jamais compris où passait son argent. L'argent filait, d'une manière ou d'une autre ; voilà tout.  Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.
Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.
Désormais son génie téméraire avait un peu pâli. La férocité des yeux noirs était atténuée par un air de continuelle tristesse, et la démarche arrogante du bohémien avait laissé la place à une figure et à un maintien inhabituellement calmes. Il demeura quelque temps sur le seuil à regarder son neveu. Le jeune homme leva les yeux brusquement et étira les mains.
— Cher oncle Dan ! s'écria-t-il en saisissant les mains que lui tendait son visiteur.
Il ne reçut, pour toute marque de compassion de la part de son oncle, qu'une pression énergique de ses doigts robustes. Les deux hommes se comprenaient trop bien pour avoir besoin de se répandre en paroles.
Daniel fixa le bureau avec sa planchette relevée.
— Alors, dit-il doucement, tu as examiné les papiers de ta mère... As-tu découvert quelque chose ?
— Plus qu'il n'est nécessaire, et pas la moitié, malgré tout, de ce que je dois savoir. Cela viendra. Oncle Dan, je ne t'ai jamais posé de questions. Je n'en trouvais pas la force. Mais maintenant... maintenant qu'elle n'est plus...
— Je te comprends, mon garçon. J'en sais moi-même assez peu, car je n'ai jamais trouvé la force de l'interroger (que Dieu la bénisse !), mais tu as le droit de savoir ce peu de choses, et si tu es en mesure de nouer les fils de l'histoire avec ce que tu as trouvé là-dedans...
En disant ces mots, Daniel lui montrait le bureau.
— Je comprends ce qui s'est passé ; ce que je veux savoir, c'est le nom de cet homme ! s'emporta Eustace.
— Cela fait vingt ans que je désire le savoir.
— Alors tu ne peux rien me dire ?
— Je peux t'en dire fort peu. Quand je suis parti de chez moi pour effectuer un stage dans un cabinet d'avocats londoniens, j'ai laissé derrière moi la plus belle et la plus lumineuse de toutes les créatures dont jamais frère ait pu se dire fier. Tu le sais, Eustace, nous étions les deux seuls enfants d'un couple de commerçants prospères dans une petite ville d'eaux. Nous habitions une maison de briques carrée qui donnait sur la mer. Mon père tenait une bibliothèque ambulante avec salon de lecture, et ma mère faisait dans la chapellerie. À eux deux ils avaient un revenu tout à fait confortable. Bayham était une petite ville endormie, loin du tumulte du monde ; un commerçant qui réussit à s'y établir finit par y bénéficier d'un bon petit monopole. Je sais que nous avions du bien et qu'à notre façon nous étions des gens importants. Ma sœur était, de Bayham, la plus belle fille. Elle a fané si vite, elle est devenue une telle épave qu'il t'est difficile d'imaginer quelle beauté c'était alors. Elle avait honte que sa beauté lui valût autant d'attention, et ses timidités d'enfant la rendaient plus charmante encore. Un grand échalas empoté de dix-huit ans ne sait guère ce qu'est la beauté, mais je savais que ma sœur était adorable ; je l'aimais et je l'admirais. Je me rappelle que je n'arrêtais pas de vanter ses mérites auprès des autres clercs, et qu'à force de dénigrer leurs sœurs du haut de mon ignorance j'avais fini par me rendre insupportable. J'étais si fier de notre petite Cely.
Il s'arrêta de parler, se couvrit les yeux de ses mains pendant quelques minutes, cependant qu'Eustace attendait impatiemment.
— Pour aller à l'essentiel, poursuivit-il, mon père a fini par m'écrire une lettre, au ton très perturbé, aux formulations presque incohérentes, afin de me dire que la maison était sens dessus dessous, et que je devais rentrer sur-le-champ. Bien sûr, je pensai d'abord à des problèmes d'ordre pécuniaire (je gage que la nature a fait de nous des êtres mesquins) et, me figurant que le commerce était ruiné, j'ai songé, rongé par le remords, à tout l'argent que j'avais coûté à mon père, et à la façon dont, depuis toujours, j'avais été un bien piètre fils. En rentrant à Bayham, j'ai découvert qu'une chose plus grave que le manque d'argent avait frappé d'affliction notre famille. Celia avait disparu en laissant une lettre dans laquelle elle disait à mon père qu'elle partait se marier ; il y avait des raisons de tenir secrets quelque temps le mariage et le nom même de son époux ; mais il avait promis de la ramener à Bayham dès qu'il serait libre de révéler son nom et son rang. Bien entendu, nous savions ce qu'il fallait comprendre par là ; mon père et moi partîmes en quête de notre pauvre fille dupée, le cœur frappé d'un désespoir aussi noir que si nous étions partis la chercher au royaume de Pluton.
— Et vous avez échoué...?
— Oui, mon garçon, nous avons ignoblement échoué. En ce temps-là, il n'y avait ni télégraphe ni détectives privés ; et après avoir suivi plusieurs fausses pistes, et dépensé pas mal d'argent, nous sommes rentrés à Bayham, mon père avec dix ans de plus pour tribut de ses peines. Il mourut trois ans plus tard, et ma mère ne tarda pas à le suivre, car c'était un de ces couples de l'ancien temps, qui s'accrochent l'un à l'autre si passionnément leur vie durant qu'il leur faut bien descendre ensemble à la tombe. Ils moururent, et la pauvre fille, à qui ils avaient pardonné dès la minute où ils avaient appris son offense, ne put soulager leurs derniers instants. Ils étaient morts depuis plus d'un an lorsque je vis un visage de femme me frôler dans la partie la plus animée du Strand. Je poursuivis mon chemin en ressentant au fond de mon cœur une étrange et subite douleur, avant de rebrousser chemin et de me lancer à la poursuite de cette femme, car je savais que j'avais vu ma sœur.
Il y eut une nouvelle pause, durant laquelle on n'entendit que la respiration haletante d'Eustace, et un long soupir, poussé par Daniel.
— Eh bien, mon garçon, elle vivait à Londres depuis plus de trois ans, cachée dans cette même immense jungle qui m'abritait, et pas une fois la Providence ne m'avait placé sur son chemin. Elle avait mené la vie qui est celle de tant d'autres créatures solitaires à Londres, en vivotant, tantôt grâce à telle besogne, tantôt grâce à telle autre. Je la raccompagnai chez elle ; nous rassemblâmes ses quelques menus biens, nous les emportâmes dans un fiacre, avec toi... et tu connais la suite. Elle a vécu avec moi jusqu'à ce que tu atteignes l'âge où les mauvaises influences sont à craindre : alors, elle prit quelque excuse pour s'en aller ; la pauvre âme, elle avait peur que ce débauché de Daniel ne contaminât son petit agneau. Pendant tout le temps où nous vécûmes ensemble, je me retins de l'interroger. J'étais persuadé qu'elle finirait par se confier à moi, et, espérant cela, j'attendais patiemment. Une fois, elle m'apprit qu'elle s'était rendue par deux fois à Bayham : la première, quand ses parents étaient encore en vie ; elle avait attendu et guetté, dissimulée par l'obscurité hivernale, jusqu'à parvenir à les apercevoir tous deux ; la seconde, quand ils reposaient déjà dans le cimetière paroissial. Elle ne m'a jamais rien dit d'autre. Un jour, je lui ai demandé si elle me dirait le nom de ton père. Mais elle m'a regardé d'un visage aussi triste qu'effrayé, la pauvre enfant, et m'a dit que non, elle ne pourrait jamais me dire cela ; il n'était pas en Angleterre... il était, à ce qu'elle croyait savoir, à l'autre bout de la terre. C'est la seule tentative que j'aie jamais faite pour deviner le secret de ta naissance.
18:56 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 16 avril 2018
Hafenkneipe ::: Joachim Ringelnatz ::: Bistrot portuaire
Depuis une semaine, je traduis, à raison d'un par jour sur Facebook, des poèmes de Joachim Ringelnatz.
En voici un en supplément.
14:26 Publié dans Darts on a slate, Pong-ping | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 14 avril 2018
DSF13 (#Braddon1868)
Chapitre III. [en cours de traduction]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.
Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.
Votre ami sincère à tout jamais,
H.
Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.
— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),
ma chère à tout jamais,
il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.
Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.
H, à toi pour toujours,
Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.
Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.
Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque. Ces mèches noires désordonnées étaient parsemées de fils d'argent, et sa moustache noire avait de ces reflets pourpre qui trahissent la main de l'apothicaire. C'était un homme grand et robuste, d'allure imposante ; et quoique les grâces habituelles de l'homme moderne lui fissent défaut, il avait quelque chose de racé, un style bien à lui. En ce jour, il portait le deuil, et ses manières avaient une douceur inaccoutumée. C'était Daniel Mayfield, un homme dont le génie avait bien servi les autres, mais été de peu de secours pour lui-même, un homme qui contemplait le visage de son pire ennemi à chaque fois qu'il regardait dans un miroir.
Oui, M. Mayfield ne s'était pas fait d'autre ennemi que lui-même. Il était aimé de tous. C'était lui, le vrai bohémien, l'Arabe typique arpentant le grand désert londonien. L'argent, comme de l'eau, lui filait entre les doigts. Il avait eu plus de réussite, et travaillé davantage que des hommes dont le labeur s'était traduit en terres et demeures, chevaux et calèches, fins linges brodés et porcelaines de Sèvres. Les gens qui le connaissaient passaient leur temps à calculer ses revenus et à se demander ce qu'il en faisait. Dépensait-il tout au jeu ou dans des spéculations boursières ? Ces quinze cents livres de revenu annuel, les buvait-il dans les tavernes ? Daniel lui-même eût été dans l'impossibilité de répondre. Cette énigme mystérieuse l'intriguait autant que les autres. Il n'avait jamais compris où passait son argent. L'argent filait, d'une manière ou d'une autre ; voilà tout.  Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.
Son ami Jack lui empruntait quelques livres sterling, et puis un soir, aux cartes, la chance n'était pas du côté du pauvre Dan, puis on donnait un dîner à Greenwich pour fêter l'anniversaire de Tom, et puis il s'enviait d'une édition ancienne fort rare du Diable boiteux, de grand format, que vendait le libraire Willis & Sotheran's, et puis il y avait des périodes passagères de disette, pendant lesquelles Dan devait faire appel à un usurier fort aimable, qui ne lui faisait, in fine, payer son charitable service qu'à un taux de 150%. Ainsi filait l'argent. Daniel était la dernière personne au monde à se soucier de la façon dont l'argent disparaissait. Quand il se trouvait désargenté, il demandait qu'on lui apportât du papier, de l'encre et une plume afin de se remettre à flot.
Désormais son génie téméraire avait un peu pâli. La férocité des yeux noirs était atténuée par un air de continuelle tristesse, et la démarche arrogante du bohémien avait laissé la place à une figure et à un maintien inhabituellement calmes. Il demeura quelque temps sur le seuil à regarder son neveu. Le jeune homme leva les yeux brusquement et étira les mains.
— Cher oncle Dan ! s'écria-t-il en saisissant les mains que lui tendait son visiteur.
Il ne reçut, pour toute marque de compassion de la part de son oncle, qu'une pression énergique de ses doigts robustes. Les deux hommes se comprenaient trop bien pour avoir besoin de se répandre en paroles.
Daniel fixa le bureau avec sa planchette relevée.
— Alors, dit-il doucement, tu as examiné les papiers de ta mère... As-tu découvert quelque chose ?
— Plus qu'il n'est nécessaire, et pas la moitié, malgré tout, de ce que je dois savoir. Cela viendra. Oncle Dan, je ne t'ai jamais posé de questions. Je n'en trouvais pas la force. Mais maintenant... maintenant qu'elle n'est plus...
— Je te comprends, mon garçon. J'en sais moi-même assez peu, car je n'ai jamais trouvé la force de l'interroger (que Dieu la bénisse !), mais tu as le droit de savoir ce peu de choses, et si tu es en mesure de nouer les fils de l'histoire avec ce que tu as trouvé là-dedans...
En disant ces mots, Daniel lui montrait le bureau.
— Je comprends ce qui s'est passé ; ce que je veux savoir, c'est le nom de cet homme ! s'emporta Eustace.
— Cela fait vingt ans que je désire le savoir.
— Alors tu ne peux rien me dire ?
— Je peux t'en dire fort peu. Quand je suis parti de chez moi pour effectuer un stage dans un cabinet d'avocats londoniens, j'ai laissé derrière moi la plus belle et la plus lumineuse de toutes les créatures dont jamais frère n'ait pu se dire fier.
23:33 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 13 avril 2018
DSF12 (#Braddon1868)
Chapitre III. [en cours de traduction]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.
Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.
Votre ami sincère à tout jamais,
H.
Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.
— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),
ma chère à tout jamais,
il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.
Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.
H, à toi pour toujours,
Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.
Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre. C'était une histoire tellement banale, et si facile à reconstituer : la belle fille de province, fragile et pauvre, qui se laisse arracher à sa petite famille sous la promesse d'une mariage clandestin, une union qui n'est jamais célébrée, et dont l'officialisation n'avait jamais été prévue, puis un bref intervalle de bonheur, comme en rêve, l'escapade à midi dans un nouveau jardin d'Éden, et ce fatal serpent, le Remords, toujours tapi sous les fleurs ; enfin, l'épilogue abrupt sur lequel s'achève ce rêve enfiévré de bonheur : amertume et noir désespoir ! Voilà quel petit roman sans originalité Eustace Thorburn retrouvait dans le paquet de lettres signées de cette initiale, H., histoire si cruelle, si humiliante que le jeune homme laissa choir sa tête recrue de fatigue parmi les papiers amoncelés pour y pleurer à chaudes larmes.
Il s'était plus ou moins remis de cet accès de chagrin et s'occupait à ranger les lettres lorsque la porte s'ouvrit ; un homme entra. L'homme avait dans les quarante-cinq ans, et d'une figure à ne pas passer inaperçu. Il avait été beau, cela ne faisait aucun doute, mais la fleur de sa jeunesse avait fané dans un environnement malsain, et les brises glaciales d'un automne précoce l'avaient flétri quand il eût dû encore resplendir de toute la gloire d'un flamboyant été. Il avait un nez cramoisi, et des yeux noirs également incandescents ; ses cheveux noirs étaient plus longs que ne le permettait la mode de l'époque.
23:28 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 12 avril 2018
DSF11 (#Braddon1868)
Chapitre III. [en cours de traduction]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.
Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.
Votre ami sincère à tout jamais,
H.
Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.
— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),
ma chère à tout jamais,
il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.
Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.
H, à toi pour toujours,
Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses. L'auteur de la lettre ne cessait de répéter qu'il avait eu le cœur meurtri de lui voir verser des larmes, et combien il lui était quasiment insupportable d'imaginer sa peine. Il était pourtant parvenu à surmonter cela et avait maintenu ses plans, quels qu'ils fussent, car la dernière lettre contenait toutes les instructions indispensables à la fuite de la jeune fille. Elle devait rejoindre son amoureux à la nuit tombée au bureau de la malle-poste ; ils feraient la première étape de nuit ; ensuite, ils s'arrêteraient dans un relais et arriveraient à Londres en empruntant une autre route ; de la sorte, ils étaient assurés de semer quiconque tenterait de les suivre ou de s'enquérir à leur sujet sur la route principale.
Rien de plus... et bien assez, pourtant, pour le jeune homme assis à ruminer sur cette dernière lettre, la mine sombre.
23:34 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 11 avril 2018
DSF10 (#Braddon1868)
Chapitre III. [en cours de traduction]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur. En effet, j'avais pris grand soin de cacher mon identité. Mais en vous entendant faire l'éloge de mon livre, je jetai toute prudence par-dessus les moulins. Quel plaisir de vous voir rougir, de voir votre embarras si envoûtant quand je vous ai dit que tout le bonheur était pour moi.
Oh, Celia, si vous aimez tant mon livre, pourquoi m'éviter et vous méfier de moi ? Permettez que je vous voie, ma chère... peu importe quand et où... vos conditions seront les miennes... Je passe mes journées à attendre dans cette ville sans charme, cela dans l'espoir de vous voir. Je suis requis ailleurs par cent tâches diverses, et pourtant j'attends ici ! Une fois que j'aurai posté cette lettre, j'attendrai une semaine ; si je ne reçois, dans ce laps de temps, aucun signe de vous, je quitterai Bayham pour ne plus jamais m'aventurer dans ses rues fatales.
Votre ami sincère à tout jamais,
H.
Six semaines s'étaient écoulés entre la deuxième lettre et la troisième, et il s'était produit un changement considérable dans le ton de leur auteur. Il n'implorait plus d'entrevue avec la fille du papetier. Il ne faisait aucun doute qu'il l'avait vue à maintes reprises, et la lettre regorgeait d'allusions à des rendez-vous passés.
— Mon tendre Amour (ainsi commençait-il — comme la situation avait évolué promptement en six semaines, après le "chère mademoiselle" des débuts),
ma chère à tout jamais,
il n'y a pas, entre de nous, de fossé aussi large qu'il ne puisse être comblé. Pourquoi avoir la cruauté de douter de moi et de me fuir ? Tu sais que je t'aime. Hier soir, quand nous étions ensemble près de la mer sous le doux crépuscule, tu m'as dit que tu croyais à mes sentiments, et le calme alentour était si solennel que nous eussions aisément pu nous croire naufragés sur quelque île déserte. Tu me parles de ton humble naissance, comme si la naissance d'un ange ou d'une déesse pouvait être humble, et tu m'implores de retourner dans le monde, d'y reprendre mon esclavage, et d'oublier cette brève illumination qui m'a fait entrevoir mieux que le monde. Celia, j'ai seulement vingt-cinq ans, et pourtant j'étais certain de ne plus pouvoir ressentir un amour tel que celui que j'éprouve pour toi.
Samedi, tu m'as dit que ton père entrerait dans une colère noire s'il apprenait notre relation. Je mettrais volontiers fin à toutes tes craintes, ma chérie, en allant voir M. Mayfield pour lui demander la permission de te dire mienne pour le restant de nos jours, si je n'étais pas pieds et poings liés par des entraves d'une nature sociale. Tu as quelque motif de te défier de moi, Celia, et si tu n'étais pas la plus généreuse des femmes je craindrais de te parler avec franchise. Quand nous serons mariés, notre union doit demeurer secrète jusqu'à tant que mon père, en mourant, me délivre de cette servitude. Peut-être me trouveras-tu lâche en m'entendant avouer que je n'ose défier ouvertement mon père, mais tu ne peux guère imaginer le degré d'esclavage auquel un fils est réduit lorsqu'il est fils unique et que son père nourrit de somptueux projets pour sa carrière. Je t'écris au sujet de ces obstacles à notre bonheur, ma douce, car lorsque tu es avec moi je ne peux évoquer les difficultés qui nous assiègent. Mes déboires s'évanouissent quand je vois ces yeux si chers se tourner vers moi. J'oublie ce monde laborieux et ses plaies ; je pourrais m'imaginer que la terre est encore la demeure des dieux et que la boîte de cette sotte de Pandore n'a pas été ouverte. Quand je suis loin de toi, tout est changé, et il ne me reste que l'espoir. Ainsi à notre prochaine rencontre je ne ferai pas d'allusion à cette lettre. Nous serons des enfants qui s'imaginent le monde à neuf. Nous marcherons, bras dessus bras dessous, le long de cette grève délicieuse qui s'étend au-delà de la baie, bien loin du tohu-bohu de la ville. Nous oublierons nos peines quotidiennes, nous oublierons que les dieux nous ont abandonnés.Ah, si seulement nous avions vécu en ces temps mythiques où Eros lui-même se fût peut-être ému de nos chagrins, et nous eût emportés vers quelque île enchantée où la fougue de notre amour fût demeurée aussi immortelle que sa divinité ! Voyons-nous à sept heures, mon cher amour. J'attendrai ta venue près du lieu habituel ; tu te débarrasseras sans mal de ta confidente, Mlle K. Aurais-tu d'ailleurs quelque idée d'un petit objet féminin qui fît plaisir à Mlle K. ? Je voudrais lui offrir un témoignage de mon admiration respectueuse ; elle a été si indulgente à notre égard, toute guindée qu'elle soit. Tu me diras si ce sera un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et je verrai ce que le bijoutier de Bayham peut nous bricoler. Et maintenant, ma chère, mon adorable, adieu pour quelques heures ; et que Phaéton pousse ses coursiers vers l'ouest et qu'il colore notre lieu préféré de la douceur crépusculaire d'une lumière violine.
H, à toi pour toujours,
Il y avait bien d'autres lettres — plus passionnées, moins primesautières —, sur un laps de temps qui était de six ou sept semaines, suivi d'une fort longue interruption, puis deux lettres écrites en janvier de l'année suivante. L'auteur des lettres était parvenu à obtenir de sa très chère Celia qu'elle consentît à un mariage clandestin. Elle devrait partir de chez elle en secret pour se rendre à Londres en sa compagnie ; tout avait été arrangé. Il était tout à fait manifeste que son consentement n'avait pu être obtenu qu'avec bien des manœuvres. Les lettres étaient pleines d'objurgations et de promesses.
_________________
Texte intégral du chapitre II.
19:19 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 10 avril 2018
DSF9 (#Braddon1868)
Chapitre III. [en cours de traduction]
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
Au George Hotel, le 15 juin 1843.
Ma chère mademoiselle,
si vous saviez le temps que j'ai perdu depuis jeudi de la semaine passée, en tentant vainement d'apercevoir, entre les partitions et les lithographies que votre père a disposées en vitrine, votre visage, vous croiriez plus volontiers ce que je vous ai dit ce jour-là. Je vous ai dit que si je ne vous voyais pas je vous écrirais, et je vous ai dit quelle serait l'adresse de ma lettre. Vous m'avez interdit d'écrire et dit sans ambages que ma lettre resterait à la poste sans qu'on vînt l'y chercher. Mais, à vous qui êtes si douce, il vous serait impossible de maintenir une telle résolution. J'ose formuler l'espoir que ces mots vous parviennent et que vous me pardonnerez de vous avoir désobéi.
Je désire tant vous revoir, ne serait-ce qu'une fois, oui, même une seule fois encore. Jour et nuit me hante l'image de ce doux visage penché sur l'un de mes livres. Vous souvenez-vous de ce jour ? c'était il y a trois semaines seulement, et pourtant c'est comme si une nouvelle existence avait commencé pour moi ce jour-là, et comme si j'avais vieilli de la moitié de mon âge. Ce visage si doux, si tendre, avec ses yeux foncés et son teint d'églantine, pourrai-je jamais l'oublier ? Cessera-t-il jamais de s'interposer entre mes livres et moi ? Hier soir je tentais de lire une sublime tragédie classique, mais vous m'en empêchiez. Électre, c'était vous : je vous voyais penchée sur l'urne cinéraire de votre frère, comme je vous avais vue penchée sur ce volume idiot dont vous avez eu la douceur de faire l'éloge. Cette tragédie grecque m'a rappelé cette théorie du destin dont on se moque en notre époque. Pourtant, dans la conduite de nos vies, le destin est assurément à la manœuvre. Le jour où je vous ai vue pour la première fois, j'étais occupé à écrire des lettres, et on m'avait donné du papier et des stylos si médiocres que je suis parti, plein d'entrain, m'en acheter de meilleure facture. Si on m'avait fourni de quoi écrire, je ne vous aurais peut-être jamais vue. Il y avait trois autres boutiques où j'eusse pu m'enquérir de ce que je désirais, mais le Destin m'a mis la main au collet et m'a conduit jusqu'à la papeterie de votre père. Je suis entré tranquillement, mes pensées à cent lieues de Bayham. Je vous ai vue, assise derrière la caisse, un livre sur les genoux, et toutes mes pensées sont revenues à Bayham, afin de se fixer sur vous à tout jamais.
Vous étiez si absorbée qu'il a fallu répéter trois fois mon humble requête d'une liasse de papier à lettres, tandis que je prenais le temps de déchiffrer le titre du livre qui vous intéressait tant. Tous les écrivains sont capables, je pense, de lire le titre de leur propre livre même à l'envers. Vous avez levé les yeux, avec un air chaste et timide ; c'est alors que vos joues se sont colorées de cette fraîcheur d'églantine. Alors je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce livre ; vous en avez fait l'éloge avec une éloquence envoûtante, tout en vous demandant quel genre d'homme était l'auteur. J'avais entendu bien des gens louer le livre, et davantage encore l'accabler d'injures ; jamais encore je n'avais ressenti la moindre tentation de m'en avouer l'auteur.
19:24 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 07 avril 2018
DSF8 (#Braddon1868)
Chapitre III.
« Reprends ces lettres qui sont l'image du bonheur. »
Dans le paquet suivant, il y avait beaucoup de billets et de lettres qu'Eustace Thorburn passa beaucoup de temps à lire, en relisant certaines, en reprenant d'autres qu'il avait d'abord parcourues rapidement. Le papier à lettres était épais, de belle facture, et il en émanait un parfum presque évanoui de mille-fleurs, imperceptible au point d'être comme le fantôme évanescent d'une fragrance disparue. Les lettres et les billets, tous datés, avaient tous la même signature : une simple initiale, la lettre H.
Eustace les lut dans l'ordre chronologique.
L'auteur du livre que lisait Mlle Mayfield ce mardi est revenu trois fois depuis à la bibliothèque, mais n'a pas eu l'heur de l'y voir. Miss Mayfield aura-t-elle la bonté d'écrire ne serait-ce qu'une ligne pour signifier quand on peut la voir ? L'auteur, qui songe ne pas devoir mériter ses louanges éloquentes, souhaite vivement un entretien avec elle, même de quelques minutes.
Au George Hotel, 6 juin 1843.
— L'auteur du livre ? répéta Eustace. Quel livre ? Cet homme était-il écrivain ?
Cette lettre avait été remise directement. La lettre suivante avait été envoyée à Bayham, cette ville de bains dans le Dorset où Daniel avait aussi envoyé ses missives.
« C. M.
En poste restante à Bayham. »
« C'est l'adresse que préfèrent les séducteurs » marmonna Eustace en dépliant la lettre.
20:41 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 06 avril 2018
DSF7 (#Braddon1868)
Chapitre II. [version intégrale]
Un examen rétrospectif.
Passer de la tranquillité médiévale de Villebrumeuse à la morne désolation de Tilbury Crescent, c'est se condamner à un changement navrant. Au lieu des toits pittoresques, des magnifiques églises anciennes, des avenues verdoyantes et de l'eau paisible, voici des rues inachevées et des rangées de maisons en briquettes, des ponts de chemin de fer à moitié construits, des puits profonds creusés récemment dans le sol argileux humide et des pelouses nauséabondes marquant l'emplacement de champs désolés. Les odeurs de soufre provenant d'une manufacture de briques imprègnent l'atmosphère de Tilbury Crescent. Le vacarme d'une route lointaine, le rugissement de tant de véhicules, la clameur passionnée des marchands des quatre saisons, tout cela vient baigner de rafales occasionnelles la morne quiétude du quartier, et l'on entend, les tympans endoloris, les voix suraiguës des enfants qui jouent à la marelle dans une rue voisine.
Ce petit labyrinthe de rues et de places, d'allées et de venelles, se trouve marqué du sceau d'une indigence empreinte de dignité avant même que les maçons n'aient achevé de quitter la plus neuve des maisons tandis qu'on voit encore, à tous les coins de rue, des squelettes sans toit qui attendent que le pauvre hère qui en a commencé la construction ait levé assez d'argent pour les finir. Le quartier est situé au nord, et les loyers de ces immeubles en briques jaunes sont bon marché. Ainsi, des pauvres de toute espèce, mais qui ont gardé leur dignité, viennent ici pour y trouver un abri. Des commis de notaires qui viennent de se marier prennent demeure dans les appartements de huit pièces, et vous devinerez, à voir le genre de stores et de rideaux, l'ornementation des portes et des petits jardins en façade, si les jeunes propriétaires ont eu de la chance à la loterie matrimoniale. De petits commerçants apportent leurs marchandises dans les petits magasins qui surgissent ici et là au coin des rues, et luttent péniblement pour gagner leur vie. De jeunes couturières patientes exposent des échantillons de mode infestés de mouches dans les vitrines, en attendant – pleines d'espoir ou, selon la rencontre, sans se faire la moindre illusion – chalands et clientes. Et, dans tant de vitrines que le promeneur en perdrait le compte, on voit des annonces pour des appartements à louer.
Eustace Thorburn arriva à Tilbury Crescent sous le soleil brûlant d'un midi de juillet. Il avait débarqué à St. Katherine's Wharf et avait marché jusqu'à ces faubourgs situés au nord. L'eût-il voulu, il était assez riche pour s'offrir un trajet en omnibus, voire même pour se payer le luxe d'un fiacre, mais c'était un jeune homme plein d'ambition, et il avait, depuis sa plus tendre jeunesse, appris à vivre d'une façon particulièrement spartiate. Il lui faudrait tenir avec les quelques livres sterling en sa possession jusqu'à son retour au Parthénée, ou jusqu'à trouver un nouvel emploi. Ainsi, il devait compter jusqu'au moindre shilling, et se méfier au penny près. La promenade dans les rues sales et animées de Londres lui parut longue et éprouvante, mais ses pensées étaient plus pénibles encore que ce voyage à pied sous le soleil du zénith, et les tristes souvenirs de sa jeunesse étaient un fardeau plus lourd que le sac qu'il portait en bandoulière.
Il frappa à la porte de l'une des maisons les plus misérables de l'allée, et y fut accueilli par une femme âgée, qui était négligée et peu soignée, mais qui avait un visage avenant, qui s'illumina quand elle reconnut le voyageur. L'instant d'après, elle se souvint du motif de sa visite, et afficha l'expression de douleur profonde que les gens assument si facilement quand ce sont les autres qui sont en deuil.
— Ah, lança-t-elle dans un sanglot, mon cher, mon pauvre M. Thorburn ! Jamais je n'aurais songé à vous voir voir revenir dans de telles circonstances, sans qu'elle soit là pour vous souhaiter la bienvenue, oh, mon pauvre petit biquet...
Le jeune homme leva la main pour calmer ce flot de propos compatissants. « Je vous en prie, ne me parlez pas de ma mère, dit-il tranquillement. Je ne peux pas le supporter, pas encore. »
La brave femme le regarda d'un air étonné. Elle s'était habituée à avoir affaire à des gens qui aimaient évoquer leur peine, et elle ne comprenait pas cette manière paisible d'écarter un sujet d'affliction. Dans son expérience, les personnes en deuil portaient le cilice et se couvraient la tête de cendres de façon à être vues de tous, et voici un jeune homme qui n'avait pas même de crêpe à son chapeau, et qui repoussait les manifestations de sa compassion amicale !
— Je suppose que je peux disposer de mon... de ce logement pendant une semaine environ... n'est-ce pas, Mme Bane ?
— Oui, monsieur. Je me suis pris la liberté de mettre une annonce car je m'ai dit que peut-être vous ne reviendriez pas... .. et si vous ne restez qu'une semaine peut-être que ça vous gênerait pas qu'on laisse l'annonce ? Il y a tant d'appartements dans ce quartier, vous voyez, et les gens sont si exigeants de nos jours que ça n'est pas commode pour une pauvre veuve. C'est une dure épreuve de se trouver seul au monde, M. Thorburn.
Eustace Thorburn avait au cœur une plaie vive que venaient toujours frapper des mains ignorantes.
« C'est une dure épreuve, pensa-t-il en se répétant les plaintes de la logeuse, de se retrouver seul au monde. Elle, elle s'est retrouvée seule au monde avant même ma naissance. »
La logeuse répéta sa question.
— Oui, oui, vous pouvez laisser l'annonce, mais ne faites pas visiter le logement aujourd'hui. Je risque de ne pas rester plus d'une semaine. Puis-je monter dès à présent ?
Mme Bane plongea la main dans une poche spacieuse et, après avoir longuement fouillé les profondeurs de ce réceptacle, elle en tira une clef, qu'elle tendit à Eustace.
— M. Mayfield m'a dit de bien fermer la porte à clef, à cause des papiers et de tout le reste... La porte de la chambre est fermée de l'intérieur.
Le jeune homme hocha la tête et grimpa les marches d'un pas vif et rapide, et non de ce pas lent et solennel que Mme Bane eût jugé convenable dans son état de deuil.
« Et moi qui pensais qu'il aurait pris ça mal...! »
Ainsi s'exclama-t-elle en retournant dans sa cuisine en sous-sol, d'où émanait généralement une atmosphère de lessive bouillante, ou l'odeur de brûlé si caractéristique du repassage.
Eustace Thorburn ouvrit la porte et entra dans la chambre où avait vécu encore tout récemment sa mère. C'était un petit salon miteux, qui donnait sur une chambre plus petite encore. C'était un logement du même genre que mille autres logements dans les faubourgs nouvellement construits. Les biens de la femme qui avait déménagé dans un lieu plus exigu encore n'aurait pas atteint vingt shillings sous le marteau du commissaire-priseur, et pourtant, tout dans cette pièce miteuse parlait à Eustace Thorburn de la défunte. Cette boîte à ouvrage délabrée de palissandre, dont le commissaire-priseur n'eût pas osé fixer l'enchère de départ à un shilling, lui évoquait l'image d'une femme patiente et affairée. La petite étagère où s'alignaient des éditions bon marché des poètes, dans une reliure faite de tissu usé, lui rappelait son doux visage, éclairé d'un éclat passager, suscité par les vers inspirés de ses poèmes préférés, qui lui faisaient quitter ce bas monde et ses douleurs terrestres. Cet encrier en porcelaine sans valeur et ce buvard usé, elle s'en était servi depuis plus de quatre ans. Eustace Thorburn prit ces objets et les porta à ses lèvres l'un après l'autre. Le baiser qu'il posa sur ces objets inanimés avait quelque chose de passionné : le baiser qu'il aurait posé sur ses lèvres pâles s'il avait été rappelé à temps pour lui dire adieu. Il embrassa les livres qu'elle lisait souvent, la plume dont elle se servait pour écrire, puis, se jetant brusquement jeté dans la chaise basse où il l'avait si souvent vue assise, s'abandonna à son chagrin. Si Mme Bane, la logeuse, avait entendu ces sanglots convulsifs et si elle avait vu les pleurs du jeune homme lui couler entre les doigts, elle n'aurait pas éprouvé le besoin de reprocher sa froideur à M. Thorburn. Longtemps il demeura dans la même position, toujours en pleurs. Mais cette douleur débordante finit par s'épuiser. Il arracha les larmes de ses yeux d'un geste d'impatience, et il se leva, calme et pâle, pour s'acquitter de la tâche qu'il s'était assignée.
Son amour pour sa mère avait été la grande passion de son existence. Elle reposait à présent en paix et pouvait affronter l'avenir en toute quiétude. Il pouvait désormais aller au-devant de son destin en ne se laissant dominer ni par l'espoir ni par la peur. C'est pour elle qu'il avait espéré ; c'est pour elle qu'il avait craint. Il était seul à présent ; sa poitrine ne devait plus servir de rempart pour la protéger contre « le fouet d'une fortune avilissante ». Le fouet pouvait bien le cingler désormais, il pourrait seulement le blesser ; et il avait déjà enduré la blessure la plus profonde que pût lui infliger la fortune scélérate. Il l'avait perdue, elle.
 Ce qui lui faisait le plus de mal était de savoir qu'elle n'avait jamais été heureuse. Son fils l'avait aimée d'une tendresse indescriptible. Il l'avait protégée, admirée adorée ; il avait travaillé pour elle ; il n'avait jamais pu la rendre heureuse. Ce tendre cœur de femme avait été trop durement blessé autrefois. Eustace Thorburn, qui savait cela, s'était montré patient car il était hors de question qu'il troublât son caractère doux par quelque mouvement d'humeur. Il savait qu'elle avait été lésée, et pourtant il ne lui avait jamais demandé le nom du coupable. Lui, son sauveur, son serviteur, n'avait jamais cherché à se venger de l'homme dont la trahison ou la méchanceté avait ruiné sa vie. Il avait gardé le silence, parce que l'interroger, c’eût été la faire souffrir ; et comment pouvait-il la faire souffrir ? Il s'était donc montré patient, en dépit d'un désir passionné qui couvait toujours dans son cœur, le désir de venger sa mère du mal qu'on lui avait fait.
Ce qui lui faisait le plus de mal était de savoir qu'elle n'avait jamais été heureuse. Son fils l'avait aimée d'une tendresse indescriptible. Il l'avait protégée, admirée adorée ; il avait travaillé pour elle ; il n'avait jamais pu la rendre heureuse. Ce tendre cœur de femme avait été trop durement blessé autrefois. Eustace Thorburn, qui savait cela, s'était montré patient car il était hors de question qu'il troublât son caractère doux par quelque mouvement d'humeur. Il savait qu'elle avait été lésée, et pourtant il ne lui avait jamais demandé le nom du coupable. Lui, son sauveur, son serviteur, n'avait jamais cherché à se venger de l'homme dont la trahison ou la méchanceté avait ruiné sa vie. Il avait gardé le silence, parce que l'interroger, c’eût été la faire souffrir ; et comment pouvait-il la faire souffrir ? Il s'était donc montré patient, en dépit d'un désir passionné qui couvait toujours dans son cœur, le désir de venger sa mère du mal qu'on lui avait fait.
Désormais, elle reposait ; le temps de la vengeance était arrivé. La même empreinte fatale qui avait détruit son bonheur avait écourté sa vie. Dans la fleur de l'âge, avant qu'une ride n'ait sillonné son front, ou qu'un fil d'argent ne soit apparu dans sa douce chevelure brune, elle avait trépassé, d'une patience indicible jusqu'à son dernier instant, mais le cœur brisé depuis si longtemps.
Le jeune homme repoussa son affliction et se mit à réfléchir à la nouvelle entreprise de sa vie.
La seule chose que désirât son esprit, c'était de se venger de l'ennemi anonyme de sa mère ; et l'idée que cet ennemi fût son propre père ne pouvait pas le moindrement adoucir son cœur ni le détourner ne fût-ce qu'une heure de l'objectif qu'il se fixait.
« Je veux, se disait-il, connaître son identité. D'abord, je dois découvrir son nom ; ensuite, je dois lui en faire honte plus que je n'ai honte de mon absence de nom. »
Il alla vers la cheminée ; sur le manteau, une lettre avait été déposée à son intention ; elle était fermée par un sceau noir qui avait dégouliné et l'adresse était écrite de la main indéchiffrable de son oncle.
C'était une lettre de quelques lignes seulement, mais l'enveloppe contenait un trousseau de clés : le jeune homme connaissait chacune d'elles. Il les prit dans un soupir et les regarda une à une, presque aussi tendrement qu'il l'avait fait pour les livres. Le moindre objet, dans cette chambre, était lié à des souvenirs, et, à chaque souvenir, la douleur qu'il avait tenté d'écarter reprenait possession de lui.
Sur une petite table, il y avait une écritoire en acajou de style vieilli, et c'est là que la locataire solitaire avait l'habitude de garder ses lettres et ses papiers, ainsi que quelques reliques sans valeur, ces bribes et débris qui, échappés à l'épave de l'espoir et du bonheur, sont tout ce que possède encore l'être le plus infortuné.
Eustace souleva la planchette après avoir ouvert la serrure aussi doucement que si sa mère s'était trouvée près de lui, endormie. Il l'avait souvent vue assise à ce bureau ; une fois, il l'avait surprise en larmes, avec un petit paquet de lettres à la main, mais il n'avait jamais pu voir ce qui était écrit sur ces papiers décolorés, noués de rubans fanés et salis par des oblitérations déjà anciennes. Et maintenant qu'elle n'était plus là, il était de son devoir d'examiner ces documents... ou, du moins, c'est ce qu'il pensait. Pourtant, l'ombre d'un remords plana dans son esprit en touchant le premier paquet, et il eut le sentiment de commettre un sacrilège. Le premier paquet portait l'inscription “Lettres de ma mère” : il contenait les missives d'une brave femme, écrites à une fille partie pour le pensionnat. Elles contenaient bien des allusions à un train de vie de bonne bourgeoisie, une famille de commerçants, semblait-il, car à l'occasion il était question d'événements qui s'étaient produits dans le magasin : « mon cher époux se surmène », ou encore « avec son caractère instable, Daniel n'est guère disposé à reprendre le commerce de son père »...
Eustace eut un petit sourire en lisant cela du pauvre Daniel, dont le tempérament instable ne laissait aucun doute avant même la réforme du système postal par Sir Rowland Hill, et qui ne s'était guère rassis en cette époque moderne du télégraphe électrique et de traverses de chemin de fer. Les lettres étaient d'une grande douceur, en raison des tendres penchants maternels qui s'y donnaient libre cours : elles étaient parsemées de fautes d'orthographes, et pas très bien écrites, mais elles débordaient d'affection. Celle qui écrivait ne cessait d'implorer sa "chère Sissy" de ne pas s'inquiéter et de patienter jusqu'aux vacances, qui ne tarderaient plus guère et permettraient à Sissy de revoir ses chers parents, car elle se languissait de leur amour, dans le grand pensionnat bourgeois, ce que l'on comprenait parfaitement à lire ces lettres écrites en réponse aux plaintes d'une jeune fille malheureuse loin de chez elle. Il y avait des friandises pour cette chère Sissy, et de menus présents : un collier de corail de la part de son père, une écharpe de la part de sa mère et, une fois, un portrait en métal de M. Edmund Kean dans le rôle d'Othello, avec une tunique écarlate en satin véritable glissée dans l'enveloppe ; c'est le pauvre Daniel, Daniel l'instable, qui avait consacré de longues heures de labeur à ce portrait sur plaque de métal qui était l'occasion, pour la mère, de longs moments de contemplation.
Eustace savait que l'auteur de ces lettres était sa grand-mère, cette grand-mère qui ne l'avait jamais tenu dans ses bras, ni pu s'ébaubir de ce bébé si mignon. Il s'attarda amoureusement sur ce papier à lettres d'un style ancien ; il eut de la joie à scruter les traits austères de la signature, Elizabeth Mayfield ; il versa même quelques larmes sur ce papier jauni qui avait déjà reçu, par le passé, son content de pleurs. Il lui était impossible d'imaginer sa mère en innocente écolière sans être envahi par l'émotion.
Le deuxième paquet ne contenait que trois lettres, envoyées à « cette chère Sissy » à son adresse familiale, après ses années d'école, et dans une écriture qu'Eustace reconnaissait vaguement. C'était la graphie énigmatique de Daniel Mayfield dans une variante de jeunesse ; en voyant cela, Eustace Thorburn eut le même petit sourire. Ces lettres avaient été envoyées depuis l'étude d'un avocat où le garçon était stagiaire, car Daniel avait persisté dans son aversion pour le métier de commerçant et s'était déclaré inapte à toute profession autre que juridique : il était convaincu que c'était là sa vocation. C'était des lettres agréables, juvéniles, truffées de mots alors à la mode : des expressions telles que « Pavoise-toi ! », « quelle drôle de capsule ! » ou encore « tu as vraiment l'œil américain », et diverses expressions qui servaient en ce temps-là à ponctuer la moindre conversation. Mais malgré toutes ces affectations argotiques et juvéniles on ressentait une véritable affection pour sa « chère petite Sissy aux yeux noirs ». Il en connaissait un bon nombre, de jolies filles, à Londres, mais aucune qui souffrît la comparaison avec sa chère Celia. « Et quand je serai sur le registre avec une affaire de premier plan, quand j'aurai mon logement à moi, un logement bien chic du côté de Saint-Martin, tu viendras t'occuper de mon ménage, ma petite Sissy ; et on aura un petit cottage à Putney, et une nacelle, et je te ferai remonter le fleuve tous les soirs après ma journée de travail ; et pendant que ma petite fleur bleue lira un roman en restant assise à la poupe, son fidèle Daniel s'entraînera à l'aviron. »
Dans les deux premières lettres, Daniel exprimait de vives espérances pour son avenir. Le jeune homme semblait penser qu'il allait franchir triomphalement les différentes étapes de sa carrière, et les promesses qu'il faisait à son unique sœur ne connaissaient presque aucune limite. Mais avec la troisième lettre, écrite six mois plus tard, tout avait changé. La vie d'un commis stagiaire était un véritable esclavage à côté duquel la vie d'un Noir dans les plantations de sucre aux Antilles devait être un délice de chaque instant. Daniel était las de son métier, et il apprenait à sa chère Sissy, qui devait lui jurer de garder le silence, que rien sur cette terre ne pourrait faire de lui un avocat.
« Ma chère Celia, écrivait-il, je ne suis pas fait pour ça ; ton Dan est trop fougueux pour prendre un jour la robe d'avocat. Je me suis efforcé d'aimer la carrière juridique, tout comme j'ai tenté d'aimer la papeterie et le prêt de livres pour complaire à nos pauvres parents, mais c'est en vain. Ne dis rien à notre pauvre petit père, car il se mettrait à grommeler qu'il a gaspillé de l'argent pour ma formation d'avocat ; avant même qu'il n'ait découvert ma désaffection pour la carrière, j'aurai entrepris une voie qui fera de moi un homme fortuné, et je pourrai lui rendre trois fois ce qu'il a dépensé. »
Alors, Daniel Mayfield se lançait dans une belle description d'un magnifique château qu'il avait tout récemment bâti... en Espagne. Dans son encrier, il avait trouvé la rivière Pactole... quelque chose de bien plus beau qu'une propriété foncière dans un cahier sur papier ministre. C'était un génie. Le souffle divin était descendu sur lui : Coke et Blackstone pouvaient bien aller se prendre avec leur code. Il était poète, essayiste, historien, romancier, dramaturge... il suffisait de demander... Depuis sa plus tendre enfance il aimait gribouiller, et depuis peu il s'était mis à gribouiller plus que jamais.
Ainsi, après les échecs et déceptions innombrables qui constituent ce Bourbier du Découragement qui est le lot de tout apprenti écrivain, il avait réussi à faire paraître un article dans un de ces magazines distrayants mal écrits et plus mal illustrés encore dont les cendres ont permis la naissance de ce magnifique phénix, le magazine Punch. Daniel l'annonçait à sa sœur : le rédacteur en chef avait promis de publier d'autres textes de cette même plume alerte. Il avait reçu la somme deux guinées pour sa péroraison qu'il n'avait « mis qu'une demi-heure à pondre », ainsi qu'il l'écrivait à sa chère Sissy. Sur la foi de cela il se lançait à calculer ses revenus futurs : pas moins de quatre guinées de l'heure pour chaque heure du jour. « M. Dufilou et M. Lelarron n'en prennent pas autant, malgré leur talent pour dénicher six sous par ici et huit sous par là. »
Un sourire triste envahit le visage d'Eustace Thorburn en lisant ces lettres. Il connaissait bien l'auteur des lettres, et il savait que le château en Espagne s'était réduit , au fil du temps, en un logis pauvre et délabré. Le jeune homme ne s'était pas dupé sur son talent ; il l'avait simplement gaspillé. Il avait ce don, mais il l'avait dilapidé à droite et à gauche sans prendre garde, en homme trop riche pour craindre l'indigence et trop fort pour redouter l'épuisement. Il avait jeté ses perles aux pourceaux et permis que l'on sertît ses diamants dans des écrins de cuivre, comme de la pacotille. La fleur de sa jeunesse avait fané, tandis que lui qui eût pu prétendre non seulement à la grandeur mais aussi à la respectabilité, but tellement plus difficile à atteindre pour quelqu'un de génial, lui n'était que Dan Mayfield, un vulgaire pisse-copie, nouvel avatar des « petites mains » de Jacob Tonson, habitué des tavernes, bohême et sans le sou, la chevelure abondante (mais de moins en moins, avec le temps), et les yeux marqués chaque jour davantage par des pattes d'oie.
Eustace rangea les lettres, d'un geste plein de respect. N'était-il pas en train de remuer les cendres de la jeunesse de sa mère, et le moindre papier renfermé dans cette écritoire n'avait-il pas été béni par les pleurs de la défunte ?
— Pauvre oncle Dan ! murmura-t-il doucement. Mon oncle si gentil, avec son optimisme à toute épreuve ! »
23:50 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 avril 2018
DSF6 (#Braddon1868)
Chapitre II.
Un examen rétrospectif.
Passer de la tranquillité médiévale de Villebrumeuse à la morne désolation de Tilbury Crescent, c'est se condamner à un changement navrant. Au lieu des toits pittoresques, des magnifiques églises anciennes, des avenues verdoyantes et de l'eau paisible, voici des rues inachevées et des rangées de maisons en briquettes, des ponts de chemin de fer à moitié construits, des puits profonds creusés récemment dans le sol argileux humide et des pelouses nauséabondes marquant l'emplacement de champs désolés. Les odeurs de soufre provenant d'une manufacture de briques imprègnent l'atmosphère de Tilbury Crescent. Le vacarme d'une route lointaine, le rugissement de tant de véhicules, la clameur passionnée des marchands des quatre saisons, tout cela vient baigner de rafales occasionnelles la morne quiétude du quartier, et l'on entend, les tympans endoloris, les voix suraiguës des enfants qui jouent à la marelle dans une rue voisine.
Ce petit labyrinthe de rues et de places, d'allées et de venelles, se trouve marqué du sceau d'une indigence empreinte de dignité avant même que les maçons n'aient achevé de quitter la plus neuve des maisons tandis qu'on voit encore, à tous les coins de rue, des squelettes sans toit qui attendent que le pauvre hère qui en a commencé la construction ait levé assez d'argent pour les finir. Le quartier est situé au nord, et les loyers de ces immeubles en briques jaunes sont bon marché. Ainsi, des pauvres de toute espèce, mais qui ont gardé leur dignité, viennent ici pour y trouver un abri. Des commis de notaires qui viennent de se marier prennent demeure dans les appartements de huit pièces, et vous devinerez, à voir le genre de stores et de rideaux, l'ornementation des portes et des petits jardins en façade, si les jeunes propriétaires ont eu de la chance à la loterie matrimoniale. De petits commerçants apportent leurs marchandises dans les petits magasins qui surgissent ici et là au coin des rues, et luttent péniblement pour gagner leur vie. De jeunes couturières patientes exposent des échantillons de mode infestés de mouches dans les vitrines, en attendant – pleines d'espoir ou, selon la rencontre, sans se faire la moindre illusion – chalands et clientes. Et, dans tant de vitrines que le promeneur en perdrait le compte, on voit des annonces pour des appartements à louer.
Eustace Thorburn arriva à Tilbury Crescent sous le soleil brûlant d'un midi de juillet. Il avait débarqué à St. Katherine's Wharf et avait marché jusqu'à ces faubourgs situés au nord. L'eût-il voulu, il était assez riche pour s'offrir un trajet en omnibus, voire même pour se payer le luxe d'un fiacre, mais c'était un jeune homme plein d'ambition, et il avait, depuis sa plus tendre jeunesse, appris à vivre d'une façon particulièrement spartiate. Il lui faudrait tenir avec les quelques livres sterling en sa possession jusqu'à son retour au Parthénée, ou jusqu'à trouver un nouvel emploi. Ainsi, il devait compter jusqu'au moindre shilling, et se méfier au penny près. La promenade dans les rues sales et animées de Londres lui parut longue et éprouvante, mais ses pensées étaient plus pénibles encore que ce voyage à pied sous le soleil du zénith, et les tristes souvenirs de sa jeunesse étaient un fardeau plus lourd que le sac qu'il portait en bandoulière.
Il frappa à la porte de l'une des maisons les plus misérables de l'allée, et y fut accueilli par une femme âgée, qui était négligée et peu soignée, mais qui avait un visage avenant, qui s'illumina quand elle reconnut le voyageur. L'instant d'après, elle se souvint du motif de sa visite, et afficha l'expression de douleur profonde que les gens assument si facilement quand ce sont les autres qui sont en deuil.
— Ah, lança-t-elle dans un sanglot, mon cher, mon pauvre M. Thorburn ! Jamais je n'aurais songé à vous voir voir revenir dans de telles circonstances, sans qu'elle soit là pour vous souhaiter la bienvenue, oh, mon pauvre petit biquet...
Le jeune homme leva la main pour calmer ce flot de propos compatissants. « Je vous en prie, ne me parlez pas de ma mère, dit-il tranquillement. Je ne peux pas le supporter, pas encore. »
La brave femme le regarda d'un air étonné. Elle s'était habituée à avoir affaire à des gens qui aimaient évoquer leur peine, et elle ne comprenait pas cette manière paisible d'écarter un sujet d'affliction. Dans son expérience, les personnes en deuil portaient le cilice et se couvraient la tête de cendres de façon à être vues de tous, et voici un jeune homme qui n'avait pas même de crêpe à son chapeau, et qui repoussait les manifestations de sa compassion amicale !
— Je suppose que je peux disposer de mon... de ce logement pendant une semaine environ... n'est-ce pas, Mme Bane ?
— Oui, monsieur. Je me suis pris la liberté de mettre une annonce car je m'ai dit que peut-être vous ne reviendriez pas... .. et si vous ne restez qu'une semaine peut-être que ça vous gênerait pas qu'on laisse l'annonce ? Il y a tant d'appartements dans ce quartier, vous voyez, et les gens sont si exigeants de nos jours que ça n'est pas commode pour une pauvre veuve. C'est une dure épreuve de se trouver seul au monde, M. Thorburn.
Eustace Thorburn avait au cœur une plaie vive que venaient toujours frapper des mains ignorantes.
« C'est une dure épreuve, pensa-t-il en se répétant les plaintes de la logeuse, de se retrouver seul au monde. Elle, elle s'est retrouvée seule au monde avant même ma naissance. »
La logeuse répéta sa question.
— Oui, oui, vous pouvez laisser l'annonce, mais ne faites pas visiter le logement aujourd'hui. Je risque de ne pas rester plus d'une semaine. Puis-je monter dès à présent ?
Mme Bane plongea la main dans une poche spacieuse et, après avoir longuement fouillé les profondeurs de ce réceptacle, elle en tira une clef, qu'elle tendit à Eustace.
— M. Mayfield m'a dit de bien fermer la porte à clef, à cause des papiers et de tout le reste... La porte de la chambre est fermée de l'intérieur.
Le jeune homme hocha la tête et grimpa les marches d'un pas vif et rapide, et non de ce pas lent et solennel que Mme Bane eût jugé convenable dans son état de deuil.
« Et moi qui pensais qu'il aurait pris ça mal...! »
Ainsi s'exclama-t-elle en retournant dans sa cuisine en sous-sol, d'où émanait généralement une atmosphère de lessive bouillante, ou l'odeur de brûlé si caractéristique du repassage.
Eustace Thorburn ouvrit la porte et entra dans la chambre où avait vécu encore tout récemment sa mère. C'était un petit salon miteux, qui donnait sur une chambre plus petite encore. C'était un logement du même genre que mille autres logements dans les faubourgs nouvellement construits. Les biens de la femme qui avait déménagé dans un lieu plus exigu encore n'aurait pas atteint vingt shillings sous le marteau du commissaire-priseur, et pourtant, tout dans cette pièce miteuse parlait à Eustace Thorburn de la défunte. Cette boîte à ouvrage délabrée de palissandre, dont le commissaire-priseur n'eût pas osé fixer l'enchère de départ à un shilling, lui évoquait l'image d'une femme patiente et affairée. La petite étagère où s'alignaient des éditions bon marché des poètes, dans une reliure faite de tissu usé, lui rappelait son doux visage, éclairé d'un éclat passager, suscité par les vers inspirés de ses poèmes préférés, qui lui faisaient quitter ce bas monde et ses douleurs terrestres. Cet encrier en porcelaine sans valeur et ce buvard usé, elle s'en était servi depuis plus de quatre ans. Eustace Thorburn prit ces objets et les porta à ses lèvres l'un après l'autre. Le baiser qu'il posa sur ces objets inanimés avait quelque chose de passionné : le baiser qu'il aurait posé sur ses lèvres pâles s'il avait été rappelé à temps pour lui dire adieu. Il embrassa les livres qu'elle lisait souvent, la plume dont elle se servait pour écrire, puis, se jetant brusquement jeté dans la chaise basse où il l'avait si souvent vue assise, s'abandonna à son chagrin. Si Mme Bane, la logeuse, avait entendu ces sanglots convulsifs et si elle avait vu les pleurs du jeune homme lui couler entre les doigts, elle n'aurait pas éprouvé le besoin de reprocher sa froideur à M. Thorburn. Longtemps il demeura dans la même position, toujours en pleurs. Mais cette douleur débordante finit par s'épuiser. Il arracha les larmes de ses yeux d'un geste d'impatience, et il se leva, calme et pâle, pour s'acquitter de la tâche qu'il s'était assignée.
Son amour pour sa mère avait été la grande passion de son existence. Elle reposait à présent en paix et pouvait affronter l'avenir en toute quiétude. Il pouvait désormais aller au-devant de son destin en ne se laissant dominer ni par l'espoir ni par la peur. C'est pour elle qu'il avait espéré ; c'est pour elle qu'il avait craint. Il était seul à présent ; sa poitrine ne devait plus servir de rempart pour la protéger contre « le fouet d'une fortune avilissante ». Le fouet pouvait bien le cingler désormais, il pourrait seulement le blesser ; et il avait déjà enduré la blessure la plus profonde que pût lui infliger la fortune scélérate. Il l'avait perdue, elle.
 Ce qui lui faisait le plus de mal était de savoir qu'elle n'avait jamais été heureuse. Son fils l'avait aimée d'une tendresse indescriptible. Il l'avait protégée, admirée adorée ; il avait travaillé pour elle ; il n'avait jamais pu la rendre heureuse. Ce tendre cœur de femme avait été trop durement blessé autrefois. Eustace Thorburn, qui savait cela, s'était montré patient car il était hors de question qu'il troublât son caractère doux par quelque mouvement d'humeur. Il savait qu'elle avait été lésée, et pourtant il ne lui avait jamais demandé le nom du coupable. Lui, son sauveur, son serviteur, n'avait jamais cherché à se venger de l'homme dont la trahison ou la méchanceté avait ruiné sa vie. Il avait gardé le silence, parce que l'interroger, c’eût été la faire souffrir ; et comment pouvait-il la faire souffrir ? Il s'était donc montré patient, en dépit d'un désir passionné qui couvait toujours dans son cœur, le désir de venger sa mère du mal qu'on lui avait fait.
Ce qui lui faisait le plus de mal était de savoir qu'elle n'avait jamais été heureuse. Son fils l'avait aimée d'une tendresse indescriptible. Il l'avait protégée, admirée adorée ; il avait travaillé pour elle ; il n'avait jamais pu la rendre heureuse. Ce tendre cœur de femme avait été trop durement blessé autrefois. Eustace Thorburn, qui savait cela, s'était montré patient car il était hors de question qu'il troublât son caractère doux par quelque mouvement d'humeur. Il savait qu'elle avait été lésée, et pourtant il ne lui avait jamais demandé le nom du coupable. Lui, son sauveur, son serviteur, n'avait jamais cherché à se venger de l'homme dont la trahison ou la méchanceté avait ruiné sa vie. Il avait gardé le silence, parce que l'interroger, c’eût été la faire souffrir ; et comment pouvait-il la faire souffrir ? Il s'était donc montré patient, en dépit d'un désir passionné qui couvait toujours dans son cœur, le désir de venger sa mère du mal qu'on lui avait fait.
Désormais, elle reposait ; le temps de la vengeance était arrivé. La même empreinte fatale qui avait détruit son bonheur avait écourté sa vie. Dans la fleur de l'âge, avant qu'une ride n'ait sillonné son front, ou qu'un fil d'argent ne soit apparu dans sa douce chevelure brune, elle avait trépassé, d'une patience indicible jusqu'à son dernier instant, mais le cœur brisé depuis si longtemps.
Le jeune homme repoussa son affliction et se mit à réfléchir à la nouvelle entreprise de sa vie.
La seule chose que désirât son esprit, c'était de se venger de l'ennemi anonyme de sa mère ; et l'idée que cet ennemi fût son propre père ne pouvait pas le moindrement adoucir son cœur ni le détourner ne fût-ce qu'une heure de l'objectif qu'il se fixait.
« Je veux, se disait-il, connaître son identité. D'abord, je dois découvrir son nom ; ensuite, je dois lui en faire honte plus que je n'ai honte de mon absence de nom. »
Il alla vers la cheminée ; sur le manteau, une lettre avait été déposée à son intention ; elle était fermée par un sceau noir qui avait dégouliné et l'adresse était écrite de la main indéchiffrable de son oncle.
C'était une lettre de quelques lignes seulement, mais l'enveloppe contenait un trousseau de clés : le jeune homme connaissait chacune d'elles. Il les prit dans un soupir et les regarda une à une, presque aussi tendrement qu'il l'avait fait pour les livres. Le moindre objet, dans cette chambre, était lié à des souvenirs, et, à chaque souvenir, la douleur qu'il avait tenté d'écarter reprenait possession de lui.
Sur une petite table, il y avait une écritoire en acajou de style vieilli, et c'est là que la locataire solitaire avait l'habitude de garder ses lettres et ses papiers, ainsi que quelques reliques sans valeur, ces bribes et débris qui, échappés à l'épave de l'espoir et du bonheur, sont tout ce que possède encore l'être le plus infortuné.
Eustace souleva la planchette après avoir ouvert la serrure aussi doucement que si sa mère s'était trouvée près de lui, endormie. Il l'avait souvent vue assise à ce bureau ; une fois, il l'avait surprise en larmes, avec un petit paquet de lettres à la main, mais il n'avait jamais pu voir ce qui était écrit sur ces papiers décolorés, noués de rubans fanés et salis par des oblitérations déjà anciennes. Et maintenant qu'elle n'était plus là, il était de son devoir d'examiner ces documents... ou, du moins, c'est ce qu'il pensait. Pourtant, l'ombre d'un remords plana dans son esprit en touchant le premier paquet, et il eut le sentiment de commettre un sacrilège. Le premier paquet portait l'inscription “Lettres de ma mère” : il contenait les missives d'une brave femme, écrites à une fille partie pour le pensionnat. Elles contenaient bien des allusions à un train de vie de bonne bourgeoisie, une famille de commerçants, semblait-il, car à l'occasion il était question d'événements qui s'étaient produits dans le magasin : « mon cher époux se surmène », ou encore « avec son caractère instable, Daniel n'est guère disposé à reprendre le commerce de son père »...
Eustace eut un petit sourire en lisant cela du pauvre Daniel, dont le tempérament instable ne laissait aucun doute avant même la réforme du système postal par Sir Rowland Hill, et qui ne s'était guère rassis en cette époque moderne du télégraphe électrique et de traverses de chemin de fer. Les lettres étaient d'une grande douceur, en raison des tendres penchants maternels qui s'y donnaient libre cours : elles étaient parsemées de fautes d'orthographes, et pas très bien écrites, mais elles débordaient d'affection. Celle qui écrivait ne cessait d'implorer sa "chère Sissy" de ne pas s'inquiéter et de patienter jusqu'aux vacances, qui ne tarderaient plus guère et permettraient à Sissy de revoir ses chers parents, car elle se languissait de leur amour, dans le grand pensionnat bourgeois, ce que l'on comprenait parfaitement à lire ces lettres écrites en réponse aux plaintes d'une jeune fille malheureuse loin de chez elle. Il y avait des friandises pour cette chère Sissy, et de menus présents : un collier de corail de la part de son père, une écharpe de la part de sa mère et, une fois, un portrait en métal de M. Edmund Kean dans le rôle d'Othello, avec une tunique écarlate en satin véritable glissée dans l'enveloppe ; c'est le pauvre Daniel, Daniel l'instable, qui avait consacré de longues heures de labeur à ce portrait sur plaque de métal qui était l'occasion, pour la mère, de longs moments de contemplation.
Eustace savait que l'auteur de ces lettres était sa grand-mère, cette grand-mère qui ne l'avait jamais tenu dans ses bras, ni pu s'ébaubir de ce bébé si mignon. Il s'attarda amoureusement sur ce papier à lettres d'un style ancien ; il eut de la joie à scruter les traits austères de la signature, Elizabeth Mayfield ; il versa même quelques larmes sur ce papier jauni qui avait déjà reçu, par le passé, son content de pleurs. Il lui était impossible d'imaginer sa mère en innocente écolière sans être envahi par l'émotion.
Le deuxième paquet ne contenait que trois lettres, envoyées à « cette chère Sissy » à son adresse familiale, après ses années d'école, et dans une écriture qu'Eustace reconnaissait vaguement. C'était la graphie énigmatique de Daniel Mayfield dans une variante de jeunesse ; en voyant cela, Eustace Thorburn eut le même petit sourire. Ces lettres avaient été envoyées depuis l'étude d'un avocat où le garçon était stagiaire, car Daniel avait persisté dans son aversion pour le métier de commerçant et s'était déclaré inapte à toute profession autre que juridique : il était convaincu que c'était là sa vocation. C'était des lettres agréables, juvéniles, truffées de mots alors à la mode : des expressions telles que « Pavoise-toi ! », « quelle drôle de capsule ! » ou encore « tu as vraiment l'œil américain », et diverses expressions qui servaient en ce temps-là à ponctuer la moindre conversation. Mais malgré toutes ces affectations argotiques et juvéniles on ressentait une véritable affection pour sa « chère petite Sissy aux yeux noirs ». Il en connaissait un bon nombre, de jolies filles, à Londres, mais aucune qui souffrît la comparaison avec sa chère Celia. « Et quand je serai sur le registre avec une affaire de premier plan, quand j'aurai mon logement à moi, un logement bien chic du côté de Saint-Martin, tu viendras t'occuper de mon ménage, ma petite Sissy ; et on aura un petit cottage à Putney, et une nacelle, et je te ferai remonter le fleuve tous les soirs après ma journée de travail ; et pendant que ma petite fleur bleue lira un roman en restant assise à la poupe, son fidèle Daniel s'entraînera à l'aviron. »
Dans les deux premières lettres, Daniel exprimait de vives espérances pour son avenir. Le jeune homme semblait penser qu'il allait franchir triomphalement les différentes étapes de sa carrière, et les promesses qu'il faisait à son unique sœur ne connaissaient presque aucune limite. Mais avec la troisième lettre, écrite six mois plus tard, tout avait changé. La vie d'un commis stagiaire était un véritable esclavage à côté duquel la vie d'un Noir dans les plantations de sucre aux Antilles devait être un délice de chaque instant. Daniel était las de son métier, et il apprenait à sa chère Sissy, qui devait lui jurer de garder le silence, que rien sur cette terre ne pourrait faire de lui un avocat.
« Ma chère Celia, écrivait-il, je ne suis pas fait pour ça ; ton Dan est trop fougueux pour prendre un jour la robe d'avocat. Je me suis efforcé d'aimer la carrière juridique, tout comme j'ai tenté d'aimer la papeterie et le prêt de livres pour complaire à nos pauvres parents, mais c'est en vain. Ne dis rien à notre pauvre petit père, car il se mettrait à grommeler qu'il a gaspillé de l'argent pour ma formation d'avocat ; avant même qu'il n'ait découvert ma désaffection pour la carrière, j'aurai entrepris une voie qui fera de moi un homme fortuné, et je pourrai lui rendre trois fois ce qu'il a dépensé. »
Alors, Daniel Mayfield se lançait dans une belle description d'un magnifique château qu'il avait tout récemment bâti... en Espagne. Dans son encrier, il avait trouvé la rivière Pactole... quelque chose de bien plus beau qu'une propriété foncière dans un cahier sur papier ministre. C'était un génie. Le souffle divin était descendu sur lui : Coke et Blackstone pouvaient bien aller se prendre avec leur code. Il était poète, essayiste, historien, romancier, dramaturge... il suffisait de demander... Depuis sa plus tendre enfance il aimait gribouiller, et depuis peu il s'était mis à gribouiller plus que jamais.
____________________________
21:01 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 04 avril 2018
DSF5 (#Braddon1868)
Chapitre II.
Un examen rétrospectif.
Passer de la tranquillité médiévale de Villebrumeuse à la morne désolation de Tilbury Crescent, c'est se condamner à un changement navrant. Au lieu des toits pittoresques, des magnifiques églises anciennes, des avenues verdoyantes et de l'eau paisible, voici des rues inachevées et des rangées de maisons en briquettes, des ponts de chemin de fer à moitié construits, des puits profonds creusés récemment dans le sol argileux humide et des pelouses nauséabondes marquant l'emplacement de champs désolés. Les odeurs de soufre provenant d'une manufacture de briques imprègnent l'atmosphère de Tilbury Crescent. Le vacarme d'une route lointaine, le rugissement de tant de véhicules, la clameur passionnée des marchands des quatre saisons, tout cela vient baigner de rafales occasionnelles la morne quiétude du quartier, et l'on entend, les tympans endoloris, les voix suraiguës des enfants qui jouent à la marelle dans une rue voisine.
Ce petit labyrinthe de rues et de places, d'allées et de venelles, se trouve marqué du sceau d'une indigence empreinte de dignité avant même que les maçons n'aient achevé de quitter la plus neuve des maisons tandis qu'on voit encore, à tous les coins de rue, des squelettes sans toit qui attendent que le pauvre hère qui en a commencé la construction ait levé assez d'argent pour les finir. Le quartier est situé au nord, et les loyers de ces immeubles en briques jaunes sont bon marché. Ainsi, des pauvres de toute espèce, mais qui ont gardé leur dignité, viennent ici pour y trouver un abri. Des commis de notaires qui viennent de se marier prennent demeure dans les appartements de huit pièces, et vous devinerez, à voir le genre de stores et de rideaux, l'ornementation des portes et des petits jardins en façade, si les jeunes propriétaires ont eu de la chance à la loterie matrimoniale. De petits commerçants apportent leurs marchandises dans les petits magasins qui surgissent ici et là au coin des rues, et luttent péniblement pour gagner leur vie. De jeunes couturières patientes exposent des échantillons de mode infestés de mouches dans les vitrines, en attendant – pleines d'espoir ou, selon la rencontre, sans se faire la moindre illusion – chalands et clientes. Et, dans tant de vitrines que le promeneur en perdrait le compte, on voit des annonces pour des appartements à louer.
Eustace Thorburn arriva à Tilbury Crescent sous le soleil brûlant d'un midi de juillet. Il avait débarqué à St. Katherine's Wharf et avait marché jusqu'à ces faubourgs situés au nord. L'eût-il voulu, il était assez riche pour s'offrir un trajet en omnibus, voire même pour se payer le luxe d'un fiacre, mais c'était un jeune homme plein d'ambition, et il avait, depuis sa plus tendre jeunesse, appris à vivre d'une façon particulièrement spartiate. Il lui faudrait tenir avec les quelques livres sterling en sa possession jusqu'à son retour au Parthénée, ou jusqu'à trouver un nouvel emploi. Ainsi, il devait compter jusqu'au moindre shilling, et se méfier au penny près. La promenade dans les rues sales et animées de Londres lui parut longue et éprouvante, mais ses pensées étaient plus pénibles encore que ce voyage à pied sous le soleil du zénith, et les tristes souvenirs de sa jeunesse étaient un fardeau plus lourd que le sac qu'il portait en bandoulière.
Il frappa à la porte de l'une des maisons les plus misérables de l'allée, et y fut accueilli par une femme âgée, qui était négligée et peu soignée, mais qui avait un visage avenant, qui s'illumina quand elle reconnut le voyageur. L'instant d'après, elle se souvint du motif de sa visite, et afficha l'expression de douleur profonde que les gens assument si facilement quand ce sont les autres qui sont en deuil.
— Ah, lança-t-elle dans un sanglot, mon cher, mon pauvre M. Thorburn ! Jamais je n'aurais songé à vous voir voir revenir dans de telles circonstances, sans qu'elle soit là pour vous souhaiter la bienvenue, oh, mon pauvre petit biquet...
Le jeune homme leva la main pour calmer ce flot de propos compatissants. « Je vous en prie, ne me parlez pas de ma mère, dit-il tranquillement. Je ne peux pas le supporter, pas encore. »
La brave femme le regarda d'un air étonné. Elle s'était habituée à avoir affaire à des gens qui aimaient évoquer leur peine, et elle ne comprenait pas cette manière paisible d'écarter un sujet d'affliction. Dans son expérience, les personnes en deuil portaient le cilice et se couvraient la tête de cendres de façon à être vues de tous, et voici un jeune homme qui n'avait pas même de crêpe à son chapeau, et qui repoussait les manifestations de sa compassion amicale !
— Je suppose que je peux disposer de mon... de ce logement pendant une semaine environ... n'est-ce pas, Mme Bane ?
— Oui, monsieur. Je me suis pris la liberté de mettre une annonce car je m'ai dit que peut-être vous ne reviendriez pas... .. et si vous ne restez qu'une semaine peut-être que ça vous gênerait pas qu'on laisse l'annonce ? Il y a tant d'appartements dans ce quartier, vous voyez, et les gens sont si exigeants de nos jours que ça n'est pas commode pour une pauvre veuve. C'est une dure épreuve de se trouver seul au monde, M. Thorburn.
Eustace Thorburn avait au cœur une plaie vive que venaient toujours frapper des mains ignorantes.
« C'est une dure épreuve, pensa-t-il en se répétant les plaintes de la logeuse, de se retrouver seul au monde. Elle, elle s'est retrouvée seule au monde avant même ma naissance. »
La logeuse répéta sa question.
— Oui, oui, vous pouvez laisser l'annonce, mais ne faites pas visiter le logement aujourd'hui. Je risque de ne pas rester plus d'une semaine. Puis-je monter dès à présent ?
Mme Bane plongea la main dans une poche spacieuse et, après avoir longuement fouillé les profondeurs de ce réceptacle, elle en tira une clef, qu'elle tendit à Eustace.
— M. Mayfield m'a dit de bien fermer la porte à clef, à cause des papiers et de tout le reste... La porte de la chambre est fermée de l'intérieur.
Le jeune homme hocha la tête et grimpa les marches d'un pas vif et rapide, et non de ce pas lent et solennel que Mme Bane eût jugé convenable dans son état de deuil.
« Et moi qui pensais qu'il aurait pris ça mal...! »
Ainsi s'exclama-t-elle en retournant dans sa cuisine en sous-sol, d'où émanait généralement une atmosphère de lessive bouillante, ou l'odeur de brûlé si caractéristique du repassage.
Eustace Thorburn ouvrit la porte et entra dans la chambre où avait vécu encore tout récemment sa mère. C'était un petit salon miteux, qui donnait sur une chambre plus petite encore. C'était un logement du même genre que mille autres logements dans les faubourgs nouvellement construits. Les biens de la femme qui avait déménagé dans un lieu plus exigu encore n'aurait pas atteint vingt shillings sous le marteau du commissaire-priseur, et pourtant, tout dans cette pièce miteuse parlait à Eustace Thorburn de la défunte. Cette boîte à ouvrage délabrée de palissandre, dont le commissaire-priseur n'eût pas osé fixer l'enchère de départ à un shilling, lui évoquait l'image d'une femme patiente et affairée. La petite étagère où s'alignaient des éditions bon marché des poètes, dans une reliure faite de tissu usé, lui rappelait son doux visage, éclairé d'un éclat passager, suscité par les vers inspirés de ses poèmes préférés, qui lui faisaient quitter ce bas monde et ses douleurs terrestres. Cet encrier en porcelaine sans valeur et ce buvard usé, elle s'en était servi depuis plus de quatre ans. Eustace Thorburn prit ces objets et les porta à ses lèvres l'un après l'autre. Le baiser qu'il posa sur ces objets inanimés avait quelque chose de passionné : le baiser qu'il aurait posé sur ses lèvres pâles s'il avait été rappelé à temps pour lui dire adieu. Il embrassa les livres qu'elle lisait souvent, la plume dont elle se servait pour écrire, puis, se jetant brusquement jeté dans la chaise basse où il l'avait si souvent vue assise, s'abandonna à son chagrin. Si Mme Bane, la logeuse, avait entendu ces sanglots convulsifs et si elle avait vu les pleurs du jeune homme lui couler entre les doigts, elle n'aurait pas éprouvé le besoin de reprocher sa froideur à M. Thorburn. Longtemps il demeura dans la même position, toujours en pleurs. Mais cette douleur débordante finit par s'épuiser. Il arracha les larmes de ses yeux d'un geste d'impatience, et il se leva, calme et pâle, pour s'acquitter de la tâche qu'il s'était assignée.
Son amour pour sa mère avait été la grande passion de son existence. Elle reposait à présent en paix et pouvait affronter l'avenir en toute quiétude. Il pouvait désormais aller au-devant de son destin en ne se laissant dominer ni par l'espoir ni par la peur. C'est pour elle qu'il avait espéré ; c'est pour elle qu'il avait craint. Il était seul à présent ; sa poitrine ne devait plus servir de rempart pour la protéger contre « le fouet d'une fortune avilissante ». Le fouet pouvait bien le cingler désormais, il pourrait seulement le blesser ; et il avait déjà enduré la blessure la plus profonde que pût lui infliger la fortune scélérate. Il l'avait perdue, elle.
 Ce qui lui faisait le plus de mal était de savoir qu'elle n'avait jamais été heureuse. Son fils l'avait aimée d'une tendresse indescriptible. Il l'avait protégée, admirée adorée ; il avait travaillé pour elle ; il n'avait jamais pu la rendre heureuse. Ce tendre cœur de femme avait été trop durement blessé autrefois. Eustace Thorburn, qui savait cela, s'était montré patient car il était hors de question qu'il troublât son caractère doux par quelque mouvement d'humeur. Il savait qu'elle avait été lésée, et pourtant il ne lui avait jamais demandé le nom du coupable. Lui, son sauveur, son serviteur, n'avait jamais cherché à se venger de l'homme dont la trahison ou la méchanceté avait ruiné sa vie. Il avait gardé le silence, parce que l'interroger, c’eût été la faire souffrir ; et comment pouvait-il la faire souffrir ? Il s'était donc montré patient, en dépit d'un désir passionné qui couvait toujours dans son cœur, le désir de venger sa mère du mal qu'on lui avait fait.
Ce qui lui faisait le plus de mal était de savoir qu'elle n'avait jamais été heureuse. Son fils l'avait aimée d'une tendresse indescriptible. Il l'avait protégée, admirée adorée ; il avait travaillé pour elle ; il n'avait jamais pu la rendre heureuse. Ce tendre cœur de femme avait été trop durement blessé autrefois. Eustace Thorburn, qui savait cela, s'était montré patient car il était hors de question qu'il troublât son caractère doux par quelque mouvement d'humeur. Il savait qu'elle avait été lésée, et pourtant il ne lui avait jamais demandé le nom du coupable. Lui, son sauveur, son serviteur, n'avait jamais cherché à se venger de l'homme dont la trahison ou la méchanceté avait ruiné sa vie. Il avait gardé le silence, parce que l'interroger, c’eût été la faire souffrir ; et comment pouvait-il la faire souffrir ? Il s'était donc montré patient, en dépit d'un désir passionné qui couvait toujours dans son cœur, le désir de venger sa mère du mal qu'on lui avait fait.
Désormais, elle reposait ; le temps de la vengeance était arrivé. La même empreinte fatale qui avait détruit son bonheur avait écourté sa vie. Dans la fleur de l'âge, avant qu'une ride n'ait sillonné son front, ou qu'un fil d'argent ne soit apparu dans sa douce chevelure brune, elle avait trépassé, d'une patience indicible jusqu'à son dernier instant, mais le cœur brisé depuis si longtemps.
Le jeune homme repoussa son affliction et se mit à réfléchir à la nouvelle entreprise de sa vie.
La seule chose que désirât son esprit, c'était de se venger de l'ennemi anonyme de sa mère ; et l'idée que cet ennemi fût son propre père ne pouvait pas le moindrement adoucir son cœur ni le détourner ne fût-ce qu'une heure de l'objectif qu'il se fixait.
« Je veux, se disait-il, connaître son identité. D'abord, je dois découvrir son nom ; ensuite, je dois lui en faire honte plus que je n'ai honte de mon absence de nom. »
Il alla vers la cheminée ; sur le manteau, une lettre avait été déposée à son intention ; elle était fermée par un sceau noir qui avait dégouliné et l'adresse était écrite de la main indéchiffrable de son oncle.
C'était une lettre de quelques lignes seulement, mais l'enveloppe contenait un trousseau de clés : le jeune homme connaissait chacune d'elles. Il les prit dans un soupir et les regarda une à une, presque aussi tendrement qu'il l'avait fait pour les livres. Le moindre objet, dans cette chambre, était lié à des souvenirs, et, à chaque souvenir, la douleur qu'il avait tenté d'écarter reprenait possession de lui.
Sur une petite table, il y avait une écritoire en acajou de style vieilli, et c'est là que la locataire solitaire avait l'habitude de garder ses lettres et ses papiers, ainsi que quelques reliques sans valeur, ces bribes et débris qui, échappés à l'épave de l'espoir et du bonheur, sont tout ce que possède encore l'être le plus infortuné.
Eustace souleva la planchette après avoir ouvert la serrure aussi doucement que si sa mère s'était trouvée près de lui, endormie. Il l'avait souvent vue assise à ce bureau ; une fois, il l'avait surprise en larmes, avec un petit paquet de lettres à la main, mais il n'avait jamais pu voir ce qui était écrit sur ces papiers décolorés, noués de rubans fanés et salis par des oblitérations déjà anciennes. Et maintenant qu'elle n'était plus là, il était de son devoir d'examiner ces documents... ou, du moins, c'est ce qu'il pensait. Pourtant, l'ombre d'un remords plana dans son esprit en touchant le premier paquet, et il eut le sentiment de commettre un sacrilège. Le premier paquet portait l'inscription “Lettres de ma mère” : il contenait les missives d'une brave femme, écrites à une fille partie pour le pensionnat. Elles contenaient bien des allusions à un train de vie de bonne bourgeoisie, une famille de commerçants, semblait-il, car à l'occasion il était question d'événements qui s'étaient produits dans le magasin : « mon cher époux se surmène », ou encore « avec son caractère instable, Daniel n'est guère disposé à reprendre le commerce de son père »...
Eustace eut un petit sourire en lisant cela du pauvre Daniel, dont le tempérament instable ne laissait aucun doute avant même la réforme du système postal par Sir Rowland Hill, et qui ne s'était guère rassis en cette époque moderne du télégraphe électrique et de traverses de chemin de fer.
____________________________
Je rappelle le principe général : je traduis depuis cinq jours — phrase à phrase, sur Twitter, et sans avoir aucune connaissance préalable du texte — le roman de Mary Elizabeth Braddon publié en 1868.
Au cinquième jour, j'en arrive à la page 12.
Les pages de l'édition archivée sont assez tassées, comme on peut le voir. Le roman compte 348 pages. On n'y est pas...
22:14 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 03 avril 2018
DSF4 (#Braddon1868)
Chapitre II.
Un examen rétrospectif.
Passer de la tranquillité médiévale de Villebrumeuse à la morne désolation de Tilbury Crescent, c'est se condamner à un changement navrant. Au lieu des toits pittoresques, des magnifiques églises anciennes, des avenues verdoyantes et de l'eau paisible, voici des rues inachevées et des rangées de maisons en briquettes, des ponts de chemin de fer à moitié construits, des puits profonds creusés récemment dans le sol argileux humide et des pelouses nauséabondes marquant l'emplacement de champs désolés. Les odeurs de soufre provenant d'une manufacture de briques imprègnent l'atmosphère de Tilbury Crescent. Le vacarme d'une route lointaine, le rugissement de tant de véhicules, la clameur passionnée des marchands des quatre saisons, tout cela vient baigner de rafales occasionnelles la morne quiétude du quartier, et l'on entend, les tympans endoloris, les voix suraiguës des enfants qui jouent à la marelle dans une rue voisine.
Ce petit labyrinthe de rues et de places, d'allées et de venelles, se trouve marqué du sceau d'une indigence empreinte de dignité avant même que les maçons n'aient achevé de quitter la plus neuve des maisons tandis qu'on voit encore, à tous les coins de rue, des squelettes sans toit qui attendent que le pauvre hère qui en a commencé la construction ait levé assez d'argent pour les finir. Le quartier est situé au nord, et les loyers de ces immeubles en briques jaunes sont bon marché. Ainsi, des pauvres de toute espèce, mais qui ont gardé leur dignité, viennent ici pour y trouver un abri. Des commis de notaires qui viennent de se marier prennent demeure dans les appartements de huit pièces, et vous devinerez, à voir le genre de stores et de rideaux, l'ornementation des portes et des petits jardins en façade, si les jeunes propriétaires ont eu de la chance à la loterie matrimoniale. De petits commerçants apportent leurs marchandises dans les petits magasins qui surgissent ici et là au coin des rues, et luttent péniblement pour gagner leur vie. De jeunes couturières patientes exposent des échantillons de mode infestés de mouches dans les vitrines, en attendant – pleines d'espoir ou, selon la rencontre, sans se faire la moindre illusion – chalands et clientes. Et, dans tant de vitrines que le promeneur en perdrait le compte, on voit des annonces pour des appartements à louer.
Eustace Thorburn arriva à Tilbury Crescent sous le soleil brûlant d'un midi de juillet. Il avait débarqué à St. Katherine's Wharf et avait marché jusqu'à ces faubourgs situés au nord. L'eût-il voulu, il était assez riche pour s'offrir un trajet en omnibus, voire même pour se payer le luxe d'un fiacre, mais c'était un jeune homme plein d'ambition, et il avait, depuis sa plus tendre jeunesse, appris à vivre d'une façon particulièrement spartiate. Il lui faudrait tenir avec les quelques livres sterling en sa possession jusqu'à son retour au Parthénée, ou jusqu'à trouver un nouvel emploi. Ainsi, il devait compter jusqu'au moindre shilling, et se méfier au penny près. La promenade dans les rues sales et animées de Londres lui parut longue et éprouvante, mais ses pensées étaient plus pénibles encore que ce voyage à pied sous le soleil du zénith, et les tristes souvenirs de sa jeunesse étaient un fardeau plus lourd que le sac qu'il portait en bandoulière.
Il frappa à la porte de l'une des maisons les plus misérables de l'allée, et y fut accueilli par une femme âgée, qui était négligée et peu soignée, mais qui avait un visage avenant, qui s'illumina quand elle reconnut le voyageur. L'instant d'après, elle se souvint du motif de sa visite, et afficha l'expression de douleur profonde que les gens assument si facilement quand ce sont les autres qui sont en deuil.
— Ah, lança-t-elle dans un sanglot, mon cher, mon pauvre M. Thorburn ! Jamais je n'aurais songé à vous voir voir revenir dans de telles circonstances, sans qu'elle soit là pour vous souhaiter la bienvenue, oh, mon pauvre petit biquet...
Le jeune homme leva la main pour calmer ce flot de propos compatissants. « Je vous en prie, ne me parlez pas de ma mère, dit-il tranquillement. Je ne peux pas le supporter, pas encore. »
La brave femme le regarda d'un air étonné. Elle s'était habituée à avoir affaire à des gens qui aimaient évoquer leur peine, et elle ne comprenait pas cette manière paisible d'écarter un sujet d'affliction. Dans son expérience, les personnes en deuil portaient le cilice et se couvraient la tête de cendres de façon à être vues de tous, et voici un jeune homme qui n'avait pas même de crêpe à son chapeau, et qui repoussait les manifestations de sa compassion amicale !
— Je suppose que je peux disposer de mon... de ce logement pendant une semaine environ... n'est-ce pas, Mme Bane ?
— Oui, monsieur. Je me suis pris la liberté de mettre une annonce car je m'ai dit que peut-être vous ne reviendriez pas... .. et si vous ne restez qu'une semaine peut-être que ça vous gênerait pas qu'on laisse l'annonce ? Il y a tant d'appartements dans ce quartier, vous voyez, et les gens sont si exigeants de nos jours que ça n'est pas commode pour une pauvre veuve. C'est une dure épreuve de se trouver seul au monde, M. Thorburn.
Eustace Thorburn avait au cœur une plaie vive que venaient toujours frapper des mains ignorantes.
« C'est une dure épreuve, pensa-t-il en se répétant les plaintes de la logeuse, de se retrouver seul au monde. Elle, elle s'est retrouvée seule au monde avant même ma naissance. »
La logeuse répéta sa question.
— Oui, oui, vous pouvez laisser l'annonce, mais ne faites pas visiter le logement aujourd'hui. Je risque de ne pas rester plus d'une semaine. Puis-je monter dès à présent ?
Mme Bane plongea la main dans une poche spacieuse et, après avoir longuement fouillé les profondeurs de ce réceptacle, elle en tira une clef, qu'elle tendit à Eustace.
— M. Mayfield m'a dit de bien fermer la porte à clef, à cause des papiers et de tout le reste... La porte de la chambre est fermée de l'intérieur.
16:16 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 02 avril 2018
DSF3 (#Braddon1868)
Chapitre 1 — Tout seul
La statue de marbre de Herbert Van Eyck se détachait sur le ciel bleu et chaud en projetant une ombre oblique sur les drapeaux éclairés par le soleil. L'après-midi de juillet touchait à sa fin. Un soleil bas baignait d'une lumière dorée les canaux de Villebrumeuse et faisait un écrin de chaque fenêtre donnant sur le couchant. Les fenêtres qui donnent sur les rues tranquilles et les places solitaires de cette ville belge endormie ne sont pas comme tant d'autres. On ne verra pas, au sein de ces grands bâtiments anciens, l'œuvre d'un théoricien moderne de l'architecture ; on ne verra pas villa du dix-neuvième siècle pointer son museau sordide parmi ces splendeurs médiévales ; l'œil n'est pas blessé par des maisons mitoyennes en faux gothique, hideuses avec leurs briques multicolores. Vivre à Villebrumeuse, c'est vivre au seizième siècle. Un calme tranquille, comme venu du passé, imprègne les rues ombragées. Les arbres verts se reflètent dans les eaux tranquilles du canal lent qui se faufile à travers la ville, et au bord des eaux paisibles, d'agréables promenades à l'ombrage des tilleuls, et des bancs en bois qui accueillent les promeneurs soucieux de se reposer à la tombée du jour. Nonobstant sa quiétude solennelle, cette Villebrumeuse n'est pas une ville lugubre. Si elle ne fait plus partie des endroits où l'on s'affaire sur cette terre — si l'océan impétueux du progrès moderne a déserté ses rivages, ne laissant entre elle et lui que grèves et récifs — cette ville paisible n'a, au pire, pas changé, pendant que la marée bruyante poursuit sa course tumultueuse, de succès en échecs — ses entreprises florissantes et ses naufrages oubliés. La paix qui règne à Villebrumeuse est la tranquillité du sommeil, non le calme effrayant de la mort. Cette ville est empreinte d'une prospérité sautillante, d'une atmosphère aisée et apaisante pour qui a l'esprit fatigué par le tumulte du monde, mais la cohue, la confusion, le grabuge et la mêlée qui sont le propre du commerce moderne y sont inconnus des paisibles marchands, lesquels se contentent de satisfaire les simples besoins de leurs concitoyens de la plus simple des façons. Et pourtant, cette ville fut jadis un marché où l'Orient apportait ses marchandises les plus somptueuses : en ces temps anciens, ces vieilles places pittoresques résonnèrent des voix de tant de commerçants et eurent le lustre éclatant de tant de gens affairés en tenues chamarrées.
Un jeune Anglais faisait les cent pas sur la large place que dominait, en y projetant son ombre lugubre, la statue du peintre. Il enseignait l'anglais et la mathématique dans un grand établissement public situé non loin, et se nommait Eustace Thorburn. Trois années durant, il avait assumé ses fonctions dans ce lycée de Villebrumeuse ; trois années durant, il avait fait son devoir, avec sérieux et modestie, et en donnant satisfaction à toutes les parties concernées. Toutefois, tel trait chez lui révélait l'enthousiaste, et tel autre le poète : on trouvait en lui bien des attributs dont tant de gens s'imaginent qu'ils valent attestation d'incapacité à s'occuper des basses tâches quotidiennes. Un esprit ardent et ambitieux luisait dans les yeux gris d'Eustace Thorburn, mais si l'épée flamboyante avait trouvé le fourreau bien terne pendant ces trois années de routine professorale et de monotonie villebrumeusienne, le jeune homme s'était montré patient et satisfait. Il y avait, à Villebrumeuse, une bibliothèque à laquelle le tuteur pouvait accéder librement, et il avait passé, dans les salles médiévales de cette institution, le plus clair de ses loisirs. Il avait eu grand plaisir à rêver ainsi, oisif, entouré de bons livres ; son métier de professeur, quoique laborieux et fastidieux par nature, était tolérable ; et il avait des tendresses cachées pour cette vieille ville pittoresque, ces canaux lents éclipsés par les arbres verts, les gens simples, les manières anciennes. Ainsi, s'il y eut des moments où l'esprit avide eût aimé à s'élever dans des régions d'une sublimité mieux marquée, le jeune tuteur n'avait point été trop infortuné que son destin l'eût amené ici, à gagner son pain parmi des inconnus.
Parmi des inconnus ? Les habitants de cette ville belge étaient-ils plus des étrangers, pour lui, que les autres habitants de cette terre populeuse, si on ne comptait pas l'homme et la femme qui étaient, à eux seuls, tout ce qu'il avait d'amis et de famille ? Parmi des inconnus ? Enfin, si la statue de Van Eyck avait pu quitter ce piédestal-là pour se promener dans les rues de la ville, ce buste animé n'aurait guère pu sembler plus esseulé que le jeune homme allant et venant à l'ombre des drapeaux inclinés en cet après-midi de juillet.
En cherchant à percer les ombres du passé, Eustace Thorburn voyait combien les images, si banales pour tant d'hommes, manquaient dans le tableau mystique que sa mémoire lui présentait. La mémoire, même en l'interrogeant au plus près, ne lui montrait — à travers la demi-conscience de l'enfance — pas même la trace vacillante d'un visage paternel. Il ne pouvait pas non plus, en passant à la loupe chaque moment de son enfance, se remémorer la moindre visite sur la tombe d'un père, la moindre mention, même accidentelle du nom d'un père, ou encore un objet, aussi banal soit-il, associé à l'existence d'un père, que ce fût un portrait, une épée, un livre, une montre, une mèche de cheveux. Il y avait eu une époque où il avait tenté d'interroger sa mère sur ce père disparu, mais cela faisait bien longtemps. Le temps était venu, trop tôt même dans sa vie, où une sagesse précoce l'avait retenu de poser des questions, et il avait appris à s'abstenir de mentionner jamais le nom d'un père, sujet de discussion à éviter par-dessus tout. À l'âge de vingt-trois ans, on ne lui avait jamais dit le nom de son père, ni ce qu'il faisait dans le monde. Au cours des dix dernières années, il était fréquemment resté éveillé dans le calme solennel de la nuit, à songer à ce père inconnu, et à se demander s'il était vivant ou mort. Il savait qu'il n'était pas fondé à porter ce nom, et qu'il avait tout autant le droit de s'appeler Guelph ou Plantagenet que Thorburn.
Pourtant, combien d'hommes sans enfants sur cette terre qui eussent été heureux de dire “mon fils” à Eustace Thorburn ! Combien de grands de ce monde, dont le nom puissant attendait un héritier, se seraient émerveillés d'une façon indescriptible s'ils avaient pu faire tinter le carillon et annoncer l'avènement de pareille progéniture ! Comme il est des fleurs rares, incomparables qui ornent des endroits inaccessibles où nulle main ne peut les cueillir, où nul œil ne peut se réjouir de leur beauté, il est, dans le monde, des êtres sans amis qui pourraient faire la joie des cœurs délaissés, et la fierté des foyers désolés. L'idée que “tout ne va pas droit dans ce monde”, chantée par le poète, imprègne toutes les relations sociales. À toutes les mélodies se mêlent, sur cette terre, les gémissements plaintifs du mode mineur ; ce n'est que progressivement que le voile se lèvera ; ce n'est que progressivement qu'on résoudra l'énigme mystique, et que les accords d'une harmonie parfaite retentiront à nos oreilles, sans être gâchés par de douloureux accents.
Rarement visage plus noble aura levé les yeux vers la figure de cette statue que celui qui la contemplait rêveusement en ce jour. Le visage du jeune homme était, comme celui de la statue, plus beau par la noblesse de son expression que pour la régularité parfaite de ses traits. Dans le visage d'Eustace Thorburn, l'éclat intellectuel dépassait tant la beauté physique que ceux qui le voyaient pour la première fois étaient surtout impressionnés par la vivacité de sa mine, et pouvaient tout à fait prendre congé de lui sans rien savoir de la forme de son nez ou de sa bouche. Tâche bien ingrate que de devoir inventorier un tel visage : les yeux gris foncé qui paraissent noirs ; la bouche agile qui, à tel instant, semble figée dans l'expression d'un orgueil inflexible et d'une volonté indomptable, et qui affiche soudain un sourire tel qu'on l'imagine incapable d'exprimer autre chose que la tendresse masculine ou l'humour badin ; la chevelure châtain coiffée à la hâte et qui donne un aspect léonin à ce profil hautain ; le teint d'une beauté quasi féminine, qui se colore différemment au gré des élans ou des émotions... tout cela commence à donner quelque idée de la personnalité du jeune Anglais qui allait et venait sur la place déserte pendant la demi-heure où il lui était loisible de s'affranchir des tâches monotones de l'après-midi.
Cette demi-heure de répit n'était pas le seul privilège de M. Thorburn. Il disposait de deux heures par jour pour étudier, deux heures qu'il passait généralement à la bibliothèque municipale, car son ambition, en prenant une forme reconnaissable, avait fini par tracer les grandes lignes d'une carrière. Il était destiné à être homme de lettres. S'il eût été riche, il se serait enfermé dans sa bibliothèque pour y devenir poète. Mais comme il n'était rien d'autre qu'un jouvenceau sans nom et sans fortune, devant gagner son pain à la sueur de son front, il ne pouvait s'autoriser le luxe de faire des vers. Il voyait devant lui la vaste arène du labeur littéraire et n'avait d'autre choix que d'entrer en lice en forçant le passage, et de se battre pour tout emploi qui se trouverait vacant. Le destin pouvait bien faire de lui ce qu'il voulait : journaliste, romancier, dramaturge, gratte-papier ou petit plumitif. Il lui faudrait en user bien cruellement avec lui avant de parvenir à éteindre le feu de ses jeunes ambitions ou de courber le cimier avec lequel il était prêt à affronter le monde. Il avait fait le choix du métier d'homme de lettres surtout parce que c'était la seule vocation qui n'exigeait pas du novice qu'il eût des moyens, et un peu parce que son seul parent était un homme qui vivait de sa plume, et qui même eût pu prospérer et se distinguer par cette plume diserte, si du moins il l'avait voulu.
La demi-heure de répit touchait à présent à son terme, et, dans le lycée non loin de là, une cloche retentit encore et encore pour appeler les élèves pour leur cours du soir. Cet appel s'adressait aussi au maître : M. Thorburn traversa la place et emprunta la rue où se trouvait une des entrées du lycée. Il poussa une petite porte en bois qui s'ouvrait dans le grand portail, et passa sous la voûte de l'entrée ; mais avant d'aller dans sa classe, il s'arrêta pour examiner un casier destiné aux lettres adressées aux maîtres. Il ne manquait presque jamais de jeter un œil à ce casier, quoiqu'il eût fort peu de correspondants, et qu'il ne reçût guère qu'une lettre par quinzaine. Aujourd'hui il y avait une lettre. En la regardant, il sentit son cœur se glacer car l'enveloppe était ornée d'un liseré noir, et de la main de son oncle maternel, qui ne lui écrivait pour ainsi dire jamais. Sa mère était infirme depuis longtemps, et une telle lettre ne pouvait avoir qu'une seule — et néfaste — signification. Depuis des mois, il attendait avec impatience son congé, en août, de sorte qu'il pût se rendre en Angleterre et passer quelques semaines heureuses avec cette mère aimée... et voilà que ces congés arriveraient trop tard.
Il se rendit dans l'une des cours lugubres, une cour de gravier entourée de hauts murs blanchis à la chaux, et y lut sa lettre. Au fur et à mesure qu'il lisait, de grosses larmes coulaient et tombaient sur la feuille légère. Dix minutes plus tôt, en marchant de long en large au soleil et en se rappelant n'avoir que deux amis au monde, il s'était plaint de sa solitude. Il savait maintenant avoir perdu celle qu'il aimait le plus. La lettre lui annonçait la mort de sa mère :
« Mon pauvre garçon, lui écrivait son oncle, il ne sert à rien de te dépêcher pour rentrer. L'enterrement aura lieu demain et sera fini à l'heure où tu liras ces mots. J'ai vu ta mère quinze jours avant sa mort, et elle m'a dit ce qu'elle n'a jamais pu te dire — que la fin était très proche. Tout s'est précipité vers la fin, et je n'étais pas dans les parages à ce moment-là ; mais on me dit qu'elle est morte paisiblement et en bonne chrétienne. C'est de toi qu'elle a parlé à la toute fin. Mme Bane me dit qu'elle a fait grand cas de ta bonté et de ton dévouement. Elle a passé les deux derniers jours à prier, la chère âme innocente !... et moi, qui ai bien plus besoin qu'elle de cela, je n'arrive pas à m'y résoudre ne serait-ce qu'une demi-heure ! La pauvre ! Mme Bane pense que c'était pour toi qu'elle priait : elle répétait ton nom si souvent, parfois dans son sommeil, parfois allongée dans un état de langueur entre la veille et le sommeil. Mais elle n'a pas voulu qu'on t'allât quérir. “C'est mieux qu'il ne soit pas là, a-t-elle dit. Il savait, me semble-t-il, que ce jour viendrait bientôt.”
« Et maintenant, mon cher, essaie de faire face à ce chagrin en garçon courageux et sincère, ce que tu es. Je ne dis rien de mon propre sentiment, car il y a des choses que l'on entend de mauvaise grâce de la bouche de certaines personnes. Tu le sais, j'aimais ma sœur, quoique, Dieu m'en est témoin, je n'aie pas su à quel point jusqu'à hier, en voyant les stores baissés chez Mme Bane et en devinant ce qui s'était passé. Souviens-toi, Eustace, qu'aussi longtemps que je gagnerai un quignon de pain, j'en garderai un morceau pour le fils de ma sœur Célia ; j'ai beau ne pas être très fréquentable, je peux être un ami fidèle. Si tu es las de cette vieille ville belge et de sa torpeur, rentre en Angleterre. On s'assurera de te trouver quelque poste. Daniel est impossible, mais il a sa petite influence, même s'il daigne rarement s'en servir pour lui-même – il est trop médiocre pour oser brosser, de lui-même, un portrait flatteur –, il ne manquera pas d'y faire appel au bénéfice d'un neveu vertueux.
« Reviens, mon garçon... une sorte de mélancolie s'est emparée de moi, et j'ai besoin de voir le visage le plus intelligent que je connaisse dans ce monde, et le seul visage que j'aime. Reviens, même s'il te faut absolument retourner dans les salons blanchis à la chaux du Parthénée. Ta pauvre mère a laissé des lettres et des papiers qu'il serait bon que tu détruises. Ma main profane refuse de s'en approcher. »
Le jeune homme rangea vivement la lettre de son oncle près de sa poitrine, et arpenta lentement la cour de récréation, en méditant sur ce qu'il venait de perdre. Près de là, dans l'une des grandes salles de classe, ses élèves l'attendaient, tous étaient aussi surpris que consternés d'un tel retard de la part du plus ponctuel des maîtres. Peu de temps auparavant, ses larmes avaient coulé à torrents sur la lettre, mais à présent il avait les yeux secs. La souffrance sourde qui remplissait sa poitrine était plus un sentiment de désolation qu'une affliction douloureuse. Avant même de se rendre en Belgique, il savait, pour l'avoir vu, que sa mère quitterait bientôt cette terre turbulente, et le tribut le plus amer qu'il avait dû payer à la pauvreté, c'était de devoir être séparé d'elle. L'ombre de cette douleur prochaine avait longtemps obscurci l'horizon de sa jeune vie. La triste réalité l'avait frappé un peu plus tôt qu'il ne l'avait envisagé, voilà tout. Baissant la tête, il se résigna à faire face à ce malheur, mais ce à quoi il ne pouvait se résoudre, c'était la façon dont il avait dû endurer cette disparition. « Seule, dans un logement loué, avec pour tout compagnon et pour tout réconfort un dur labeur, mal payé...! Mère, ô ma mère, tu étais trop brillante pour un destin aussi triste ! »
Alors apparaissait devant les yeux du jeune homme une des images qui ne cessait de le hanter : l'image de ce que leur vie aurait pu être, à sa mère et lui, si la situation avait été différente. Il se voyait en fils bien-aimé et reconnu d'un homme bon et honorable ; il imaginait sa mère en épouse heureuse. Ah, comme tout eût été différent alors ! La maladie et la mort seraient advenues, peut-être, puisqu'il n'est point de barrière terrestre qui puisse tenir ces sombres visiteurs éloignés des familles heureuses. Ils seraient venus, ces hôtes redoutés, mais sans être perçus de la même façon...! Il se représentait deux lits de mort. Au pied d'un de ces deux lits se tenaient, à genoux, des enfants aimants, pleurant silencieusement une mère mourante, tandis qu'un mari en deuil réprimait toutes les marques extérieures de son affliction, de crainte d'importuner, au moment de quitter le monde, l'esprit dont il soutenait, de ses bras affectueux, le tabernacle terrestre. Et l'autre lit de mort... hélas, quel contraste affligeant entre ces deux tableaux ! Une femme seule dans une chambre miteuse, abandonnée et oubliée de tous, sauf de son fils, qui vivait loin d'elle. « Et pour ça, marmonna le jeune homme, pour ça comme pour le reste, nous devons le remercier, lui! » Son visage, qui jusqu'alors n'avait été assombri que par un découragement serein, s'assombrit soudain en disant ces mots. Ce n'était pas la première fois qu'il s'adressait ainsi, avec amertume, à un ennemi anonyme. Il s'était très souvent laissé aller à des pensées vengeresses contre cet ennemi inconnu à la méchanceté duquel il imputait tous ses malheurs ainsi que tous les chagrins cachés et les souffrances que sa mère avait endurées en silence. Il tenait un compte précis des torts subis par sa mère et par lui-même, et il plaçait en face, dans le balance, cette personne qu'il n'avait jamais vue et dont il ne découvrirait peut-être jamais le nom.
Cet ennemi anonyme, c'était son père.
Chapitre II.
Un examen rétrospectif.
Passer de la tranquillité médiévale de Villebrumeuse à la morne désolation de Tilbury Crescent, c'est se condamner à un changement navrant. Au lieu des toits pittoresques, des magnifiques églises anciennes, des avenues verdoyantes et de l'eau paisible, voici des rues inachevées et des rangées de maisons en briquettes, des ponts de chemin de fer à moitié construits, des puits profonds creusés récemment dans le sol argileux humide et des pelouses nauséabondes marquant l'emplacement de champs désolés. Les odeurs de soufre provenant d'une manufacture de briques imprègnent l'atmosphère de Tilbury Crescent. Le vacarme d'une route lointaine, le rugissement de tant de véhicules, la clameur passionnée des marchands des quatre saisons, tout cela vient baigner de rafales occasionnelles la morne quiétude du quartier, et l'on entend, les tympans endoloris, les voix suraiguës des enfants qui jouent à la marelle dans une rue voisine.
Ce petit labyrinthe de rues et de places, d'allées et de venelles, se trouve marqué du sceau d'une indigence empreinte de dignité avant même que les maçons n'aient achevé de quitter la plus neuve des maisons tandis qu'on voit encore, à tous les coins de rue, des squelettes sans toit qui attendent que le pauvre hère qui en a commencé la construction ait levé assez d'argent pour les finir. Le quartier est situé au nord, et les loyers de ces immeubles en briques jaunes sont bon marché. Ainsi, des pauvres de toute espèce, mais qui ont gardé leur dignité, viennent ici pour y trouver un abri. Des commis de notaires qui viennent de se marier prennent demeure dans les appartements de huit pièces, et vous devinerez, à voir le genre de stores et de rideaux, l'ornementation des portes et des petits jardins en façade, si les jeunes propriétaires ont eu de la chance à la loterie matrimoniale. De petits commerçants apportent leurs marchandises dans les petits magasins qui surgissent ici et là au coin des rues, et luttent péniblement pour gagner leur vie. De jeunes couturières patientes exposent des échantillons de mode infestés de mouches dans les vitrines, en attendant – pleines d'espoir ou, selon la rencontre, sans se faire la moindre illusion – chalands et clientes. Et, dans tant de vitrines que le promeneur en perdrait le compte, on voit des annonces pour des appartements à louer.
Eustace Thorburn arriva à Tilbury Crescent sous le soleil brûlant d'un midi de juillet. Il avait débarqué à St. Katherine's Wharf et avait marché jusqu'à ces faubourgs situés au nord. L'eût-il voulu, il était assez riche pour s'offrir un trajet en omnibus, voire même pour se payer le luxe d'un fiacre, mais c'était un jeune homme plein d'ambition, et il avait, depuis sa plus tendre jeunesse, appris à vivre d'une façon particulièrement spartiate. Il lui faudrait tenir avec les quelques livres sterling en sa possession jusqu'à son retour au Parthénée, ou jusqu'à trouver un nouvel emploi. Ainsi, il devait compter jusqu'au moindre shilling, et se méfier au penny près. La promenade dans les rues sales et animées de Londres lui parut longue et éprouvante, mais ses pensées étaient plus pénibles encore que ce voyage à pied sous le soleil du zénith, et les tristes souvenirs de sa jeunesse étaient un fardeau plus lourd que le sac qu'il portait en bandoulière.
_______________________________
Aujourd'hui, pour la troisième journée de traduction, j'ai un peu innové, en usant des hashtags à la fois comme pense-bête (problèmes de lexique) et comme indication d'opération traductologique, mais aussi en commençant à illustrer, de loin en loin, au moyen d'images permettant de comprendre tel trajet ou tel détail de la topographie.
Dès demain, beaucoup moins de temps : ce sera une phrase par ci par là.
21:59 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 01 avril 2018
DSF2 (#Braddon1868)
Chapitre 1 — Tout seul
La statue de marbre de Herbert Van Eyck se détachait sur le ciel bleu et chaud en projetant une ombre oblique sur les drapeaux éclairés par le soleil. L'après-midi de juillet touchait à sa fin. Un soleil bas baignait d'une lumière dorée les canaux de Villebrumeuse et faisait un écrin de chaque fenêtre donnant sur le couchant. Les fenêtres qui donnent sur les rues tranquilles et les places solitaires de cette ville belge endormie ne sont pas comme tant d'autres. On ne verra pas, au sein de ces grands bâtiments anciens, l'œuvre d'un théoricien moderne de l'architecture ; on ne verra pas villa du dix-neuvième siècle pointer son museau sordide parmi ces splendeurs médiévales ; l'œil n'est pas blessé par des maisons mitoyennes en faux gothique, hideuses avec leurs briques multicolores. Vivre à Villebrumeuse, c'est vivre au seizième siècle. Un calme tranquille, comme venu du passé, imprègne les rues ombragées. Les arbres verts se reflètent dans les eaux tranquilles du canal lent qui se faufile à travers la ville, et au bord des eaux paisibles, d'agréables promenades à l'ombrage des tilleuls, et des bancs en bois qui accueillent les promeneurs soucieux de se reposer à la tombée du jour. Nonobstant sa quiétude solennelle, cette Villebrumeuse n'est pas une ville lugubre. Si elle ne fait plus partie des endroits où l'on s'affaire sur cette terre — si l'océan impétueux du progrès moderne a déserté ses rivages, ne laissant entre elle et lui que grèves et récifs — cette ville paisible n'a, au pire, pas changé, pendant que la marée bruyante poursuit sa course tumultueuse, de succès en échecs — ses entreprises florissantes et ses naufrages oubliés. La paix qui règne à Villebrumeuse est la tranquillité du sommeil, non le calme effrayant de la mort. Cette ville est empreinte d'une prospérité sautillante, d'une atmosphère aisée et apaisante pour qui a l'esprit fatigué par le tumulte du monde, mais la cohue, la confusion, le grabuge et la mêlée qui sont le propre du commerce moderne y sont inconnus des paisibles marchands, lesquels se contentent de satisfaire les simples besoins de leurs concitoyens de la plus simple des façons. Et pourtant, cette ville fut jadis un marché où l'Orient apportait ses marchandises les plus somptueuses : en ces temps anciens, ces vieilles places pittoresques résonnèrent des voix de tant de commerçants et eurent le lustre éclatant de tant de gens affairés en tenues chamarrées.
Un jeune Anglais faisait les cent pas sur la large place que dominait, en y projetant son ombre lugubre, la statue du peintre. Il enseignait l'anglais et la mathématique dans un grand établissement public situé non loin, et se nommait Eustace Thorburn. Trois années durant, il avait assumé ses fonctions dans ce lycée de Villebrumeuse ; trois années durant, il avait fait son devoir, avec sérieux et modestie, et en donnant satisfaction à toutes les parties concernées. Toutefois, tel trait chez lui révélait l'enthousiaste, et tel autre le poète : on trouvait en lui bien des attributs dont tant de gens s'imaginent qu'ils valent attestation d'incapacité à s'occuper des basses tâches quotidiennes. Un esprit ardent et ambitieux luisait dans les yeux gris d'Eustace Thorburn, mais si l'épée flamboyante avait trouvé le fourreau bien terne pendant ces trois années de routine professorale et de monotonie villebrumeusienne, le jeune homme s'était montré patient et satisfait. Il y avait, à Villebrumeuse, une bibliothèque à laquelle le tuteur pouvait accéder librement, et il avait passé, dans les salles médiévales de cette institution, le plus clair de ses loisirs. Il avait eu grand plaisir à rêver ainsi, oisif, entouré de bons livres ; son métier de professeur, quoique laborieux et fastidieux par nature, était tolérable ; et il avait des tendresses cachées pour cette vieille ville pittoresque, ces canaux lents éclipsés par les arbres verts, les gens simples, les manières anciennes. Ainsi, s'il y eut des moments où l'esprit avide eût aimé à s'élever dans des régions d'une sublimité mieux marquée, le jeune tuteur n'avait point été trop infortuné que son destin l'eût amené ici, à gagner son pain parmi des inconnus.
Parmi des inconnus ? es habitants de cette ville belge étaient-ils plus des étrangers, pour lui, que les autres habitants de cette terre populeuse, si on ne comptait pas l'homme et la femme qui étaient, à eux seuls, tout ce qu'il avait d'amis et de famille ? Parmi des inconnus ? Enfin, si la statue de Van Eyck avait pu quitter ce piédestal-là pour se promener dans les rues de la ville, ce buste animé n'aurait guère pu sembler plus esseulé que le jeune homme allant et venant à l'ombre des drapeaux inclinés en cet après-midi de juillet.
En cherchant à percer les ombres du passé, Eustace Thorburn voyait combien les images, si banales pour tant d'hommes, manquaient dans le tableau mystique que sa mémoire lui présentait. La mémoire, même en l'interrogeant au plus près, ne lui montrait — à travers la demi-conscience de l'enfance — pas même la trace vacillante d'un visage paternel. Il ne pouvait pas non plus, en passant à la loupe chaque moment de son enfance, se remémorer la moindre visite sur la tombe d'un père, la moindre mention, même accidentelle du nom d'un père, ou encore un objet, aussi banal soit-il, associé à l'existence d'un père, que ce fût un portrait, une épée, un livre, une montre, une mèche de cheveux. Il y avait eu une époque où il avait tenté d'interroger sa mère sur ce père disparu, mais cela faisait bien longtemps. Le temps était venu, trop tôt même dans sa vie, où une sagesse précoce l'avait retenu de poser des questions, et il avait appris à s'abstenir de mentionner jamais le nom d'un père, sujet de discussion à éviter par-dessus tout. À l'âge de vingt-trois ans, on ne lui avait jamais dit le nom de son père, ni ce qu'il faisait dans le monde. Au cours des dix dernières années, il était fréquemment resté éveillé dans le calme solennel de la nuit, à songer à ce père inconnu, et à se demander s'il était vivant ou mort. Il savait qu'il n'était pas fondé à porter ce nom, et qu'il avait tout autant le droit de s'appeler Guelph ou Plantagenet que Thorburn.
Pourtant, combien d'hommes sans enfants sur cette terre qui eussent été heureux de dire “mon fils” à Eustace Thorburn ! Combien de grands de ce monde, dont le nom puissant attendait un héritier, se seraient émerveillés d'une façon indescriptible s'ils avaient pu faire tinter le carillon et annoncer l'avènement de pareille progéniture ! Comme il est des fleurs rares, incomparables qui ornent des endroits inaccessibles où nulle main ne peut les cueillir, où nul œil ne peut se réjouir de leur beauté, il est, dans le monde, des êtres sans amis qui pourraient faire la joie des cœurs délaissés, et la fierté des foyers désolés. L'idée que “tout ne va pas droit dans ce monde”, chantée par le poète, imprègne toutes les relations sociales. À toutes les mélodies se mêlent, sur cette terre, les gémissements plaintifs du mode mineur ; ce n'est que progressivement que le voile se lèvera ; ce n'est que progressivement qu'on résoudra l'énigme mystique, et que les accords d'une harmonie parfaite retentiront à nos oreilles, sans être gâchés par de douloureux accents.
Rarement visage plus noble aura levé les yeux vers la figure de cette statue que celui qui la contemplait rêveusement en ce jour. Le visage du jeune homme était, comme celui de la statue, plus beau par la noblesse de son expression que pour la régularité parfaite de ses traits. Dans le visage d'Eustace Thorburn, l'éclat intellectuel dépassait tant la beauté physique que ceux qui le voyaient pour la première fois étaient surtout impressionnés par la vivacité de sa mine, et pouvaient tout à fait prendre congé de lui sans rien savoir de la forme de son nez ou de sa bouche. Tâche bien ingrate que de devoir inventorier un tel visage : les yeux gris foncé qui paraissent noirs ; la bouche agile qui, à tel instant, semble figée dans l'expression d'un orgueil inflexible et d'une volonté indomptable, et qui affiche soudain un sourire tel qu'on l'imagine incapable d'exprimer autre chose que la tendresse masculine ou l'humour badin ; la chevelure châtain coiffée à la hâte et qui donne un aspect léonin à ce profil hautain ; le teint d'une beauté quasi féminine, qui se colore différemment au gré des élans ou des émotions... tout cela commence à donner quelque idée de la personnalité du jeune Anglais qui allait et venait sur la place déserte pendant la demi-heure où il lui était loisible de s'affranchir des tâches monotones de l'après-midi.
Cette demi-heure de répit n'était pas le seul privilège de M. Thorburn. Il disposait de deux heures par jour pour étudier, deux heures qu'il passait généralement à la bibliothèque municipale, car son ambition, en prenant une forme reconnaissable, avait fini par tracer les grandes lignes d'une carrière. Il était destiné à être homme de lettres. S'il eût été riche, il se serait enfermé dans sa bibliothèque pour y devenir poète. Mais comme il n'était rien d'autre qu'un jouvenceau sans nom et sans fortune, devant gagner son pain à la sueur de son front, il ne pouvait s'autoriser le luxe de faire des vers. Il voyait devant lui la vaste arène du labeur littéraire et n'avait d'autre choix que d'entrer en lice en forçant le passage, et de se battre pour tout emploi qui se trouverait vacant. Le destin pouvait bien faire de lui ce qu'il voulait : journaliste, romancier, dramaturge, gratte-papier ou petit plumitif. Il lui faudrait en user bien cruellement avec lui avant de parvenir à éteindre le feu de ses jeunes ambitions ou de courber le cimier avec lequel il était prêt à affronter le monde. Il avait fait le choix du métier d'homme de lettres surtout parce que c'était la seule vocation qui n'exigeait pas du novice qu'il eût des moyens, et un peu parce que son seul parent était un homme qui vivait de sa plume, et qui même eût pu prospérer et se distinguer par cette plume diserte, si du moins il l'avait voulu.
La demi-heure de répit touchait à présent à son terme, et, dans le lycée non loin de là, une cloche retentit encore et encore pour appeler les élèves pour leur cours du soir. Cet appel s'adressait aussi au maître : M. Thorburn traversa la place et emprunta la rue où se trouvait une des entrées du lycée. Il poussa une petite porte en bois qui s'ouvrait dans le grand portail, et passa sous la voûte de l'entrée ; mais avant d'aller dans sa classe, il s'arrêta pour examiner un casier destiné aux lettres adressées aux maîtres. Il ne manquait presque jamais de jeter un œil à ce casier, quoiqu'il eût fort peu de correspondants, et qu'il ne reçût guère qu'une lettre par quinzaine. Aujourd'hui il y avait une lettre. En la regardant, il sentit son cœur se glacer car l'enveloppe était ornée d'un liseré noir, et de la main de son oncle maternel, qui ne lui écrivait pour ainsi dire jamais. Sa mère était infirme depuis longtemps, et une telle lettre ne pouvait avoir qu'une seule — et néfaste — signification. Depuis des mois, il attendait avec impatience son congé, en août, de sorte qu'il pût se rendre en Angleterre et passer quelques semaines heureuses avec cette mère aimée... et voilà que ces congés arriveraient trop tard.
____________________________
Hier, 31 mars 2018, j'ai commencé à traduire, phrase après phrase, sur Twitter, un roman de Mary Elizabeth Braddon dont j'ignorais l'existence jusqu'alors et pour la seule raison qu'il a été publié il y a 150 ans : Dead-Sea Fruit.
Après chaque journée de traduction sur Twitter, je recopie ici la traduction en la retouchant éventuellement. Le labeur de ce matin (2 ou 3 heures avec pas mal d'interruptions) correspond à environ 75 tweets.
Peu de principes, mais :
- je m'interdis de lire la suite et ne traduis que des phrases que je n'ai donc jamais lues
- je reprends à chaque nouvelle journée la totalité du texte depuis le début du chapitre en cours (de sorte que le lecteur peut lire aujourd'hui la totalité du texte traduit jusqu'à présent du chapitre 1)
- j'écris un petit texte comme celui-ci pour indiquer d'éventuelles informations complémentaires
19:42 Publié dans #Braddon1868 | Lien permanent | Commentaires (0)